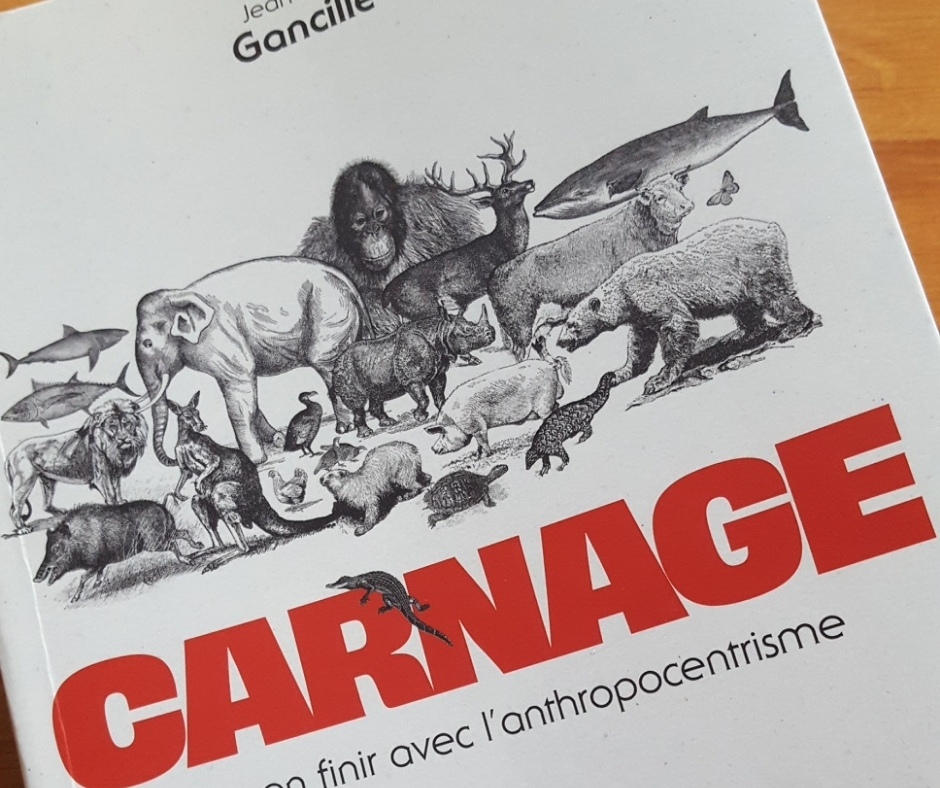
« Carnage » : repeindre l’antispécisme en vert
Carnage – Pour en finir avec l’anthropocentrisme est un livre de Jean-Marc Gancille sorti en 2020. Il rencontre un certain succès et vient de remporter le prix du livre animaliste francophone 2020[i]. L’analyse de l’auteur pose de multiples problèmes. On y trouve de nombreux éléments contradictoires rendant le propos incohérent, des faits omis – intentionnellement ou non – et beaucoup de philosophie hors-sol déconnectée de la réalité physique de ce monde. Usant de toute son expérience acquise chez Orange Aquitaine en tant que responsable de la communication, l’objectif de Gancille est d’amener sournoisement le lecteur à la seule et unique solution qui s’imposerait pour vivre dans les limites écologiques planétaires – l’humanité devrait cesser de consommer des produits issus d’animaux.
Jean-Marc Gancille remonte très loin dans le temps pour nous expliquer, dès le début du livre, que l’espèce humaine est intrinsèquement nuisible :
« L’extermination des animaux n’est pas un phénomène récent qui se serait juste accéléré par l’expansion de la civilisation humaine. C’est une constante intangible qui dure depuis plus de 125 000 ans. Chaque arrivée d’Homo Sapiens sur un continent s’accompagne d’un déclin de la mégafaune. »
Le débat fait rage depuis déjà de nombreuses années quant à la cause d’extinction de la mégafaune du Pléistocène – mammouths, marsupiaux géants, rhinocéros laineux, paresseux géants, ours et lions des cavernes, etc. Gancille cite le modèle de l’overkill ou du blitzkrieg développé dans les années 1960 par le chercheur en géosciences Paul S. Martin et selon lequel les différentes communautés de chasseurs-cueilleurs sorties d’Afrique, à leur arrivée en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie, auraient systématiquement chassé les grands animaux au-delà du seuil permettant aux populations de se maintenir. Problème, l’inconscient collectif occidental déconnecté depuis des lustres de la nature assimile la chasse à une extermination. Si c’était vraiment le cas, l’espèce humaine se serait éteinte il y a bien longtemps.
Une étude intitulée Le modèle overkill et son impact sur la recherche environnementale, publiée en 2018 dans la revue scientifique Ecology and Evolution[ii], détaille le modèle overkill et précise à ce sujet qu’il existe encore des « débats considérables » entre les différentes disciplines, notamment entre la science écologique et l’archéologie où les échanges interdisciplinaires sont très limités. Les écologues perçoivent très souvent les humains comme essentiellement nuisibles, agissant depuis toujours tels des « surconsommateurs égoïstes ». Les auteurs du papier précisent par ailleurs que la démocratisation de la théorie de Paul S. Martin s’est faite parallèlement à la montée de l’environnementalisme et de la prise de conscience en Occident de l’impact dévastateur de la société moderne sur les écosystèmes planétaires. Rien n’exclut par conséquent un fort biais culturel dans cette version de l’histoire. Il suffit par exemple de lire Et si le vivant était anarchique – la génétique est-elle une gigantesque arnaque ?, un ouvrage passionnant écrit par le biologiste et épistémologue français Jean-Jacques Kupiec, pour se rendre compte que la science est depuis toujours influencée par le cadre culturel.
Lisa Nagaoka, Torben Rick et Steve Wolverton ont interrogé 91 archéologues sur les causes d’extinction de la mégafaune en Amérique du Nord ; 82 % pensent que les extinctions résultent d’une multitude de facteurs, le changement climatique étant la seule cause unique identifiée. La plupart des personnes interrogées ont identifié plus souvent le changement climatique comme l’une des causes, l’autre facteur étant l’impact humain, soit directement par la chasse, soit indirectement par la modification des paysages. L’overkill n’est donc pas la raison principale des extinctions.
La théorie de l’overkill se base sur plusieurs hypothèses clés.
« Island analogy » (analogie de l’île) : les mécanismes qui ont provoqué l’extinction de la mégafaune sont similaires à ceux touchant la faune des îles lors de l’arrivée d’une nouvelle espèce. Martin fournit des exemples préhistoriques et historiques d’extinctions qui se sont produites sur des îles (Madagascar, Nouvelle-Zélande, Hawaï et des îles du Pacifique) et qui ont coïncidé avec la colonisation humaine. Les espèces animales isolées depuis une longue période sur une île présentent des caractéristiques dites « naïves », comme par exemple le fait de nicher à même le sol et de ne pas être capables de voler pour les oiseaux. Moins populeuses, plus vulnérables à la prédation et aux perturbations environnementales, la probabilité d’extinction des espèces insulaires est naturellement plus élevée.
Martin développa une seconde hypothèse énonçant que la mégafaune présentait des caractéristiques similaires à la faune insulaire parce que les humains sont des « superprédateurs », notamment en raison des techniques de chasse sophistiquées employées et des outils fabriqués (lance, arc, sagaie, etc.) par les chasseurs préhistoriques. Les humains de l’époque étaient si efficaces à la chasse que les grands animaux n’auraient pas eu le temps de développer une réponse évolutive. Le papier d’Ecology and Evolution précise cependant que cette hypothèse « est souvent présentée comme un fait » alors que « ni le degré d’efficacité de la chasse humaine, ni l’absence de réaction évolutive aux prédateurs chez les animaux ciblés n’ont encore été évalués ou démontrés. »
Une troisième hypothèse concerne les exigences empiriques du modèle. Il est important d’avoir à disposition des preuves archéologiques – outils en pierre enchâssés dans des carcasses, traces de coupe indiquant un dépècement, os brûlés révélant des traces de cuisson – prouvant des interactions entre humains préhistoriques et mégafaune. Or, il existe très peu de preuves archéologiques. Les humains n’ont été associés directement qu’à cinq genres sur trente-sept appartenant à la mégafaune (mammouths, mastodons, gomphothères, chameaux et chevaux), les mammouths étant les plus représentés. D’autre part, plus de 95 % des sites de fouilles présentant des restes appartenant à ces cinq genres sont de type paléontologique, c’est-à-dire des carcasses ne présentant aucune trace attribuable à des humains. L’étude précise donc qu’« il existe beaucoup de sites où il n’existe aucune association entre la mégafaune éteinte et les humains. » Pour ne rien arranger, seuls entre 15 et 26 sites archéologiques attestent d’une interaction directe. Certaines espèces ont disparu avant l’arrivée d’Homo Sapiens et d’autres ont coexisté avec les humains avant de disparaître. Mais selon Martin, ce manque de preuves s’expliquerait simplement par le fait que le processus d’extinction était trop rapide et les restes des parties de chasse enterrés. Mais selon les auteurs de l’étude d’Ecology and Evolution, prétendre que « l’absence de preuves est une preuve n’est pas une méthode scientifique pour vérifier une hypothèse. »
Donald K. Grayson et David J. Meltzer présentent la chose en ces termes :
« Malgré un manque évident de données archéologiques empiriques, la théorie de l’overkill a été adoptée sur la base d’une conviction par un petit groupe influent d’écologues et utilisée pour soutenir ce qui est essentiellement une position politique. »
« […] la théorie de l’overkill a capté l’imaginaire populaire à une époque où l’on s’inquiétait beaucoup du comportement destructeur de notre espèce envers la vie sur terre… [elle] est inextricablement liée aux temps modernes et aux sermons sur la destruction écologique. »
Le papier d’Ecology and Evolution poursuit :
« Ainsi, ils affirment que l’overkill est utilisé comme preuve des dommages que les humains peuvent causer à l’environnement. Si les humains ont causé des extinctions massives pendant des milliers d’années, ils sont et seront toujours une force destructrice et une menace importante pour la biodiversité. »
Un peu plus loin, la conclusion logique à ce raisonnement devient :
« Malheureusement, la solution extrême, mais logique, pour régénérer l’environnement serait de débarrasser la planète des humains. »
Pour éviter la destruction de la biodiversité, il faut alors séparer les humains et de la nature :
« S’il est clair que les populations humaines ont aujourd’hui un impact significatif sur l’environnement, c’est une autre histoire de chercher à faire remonter ces comportements dans le temps, surtout lorsque le sujet fait l’objet d’un débat considérable (voir Bartlett et al., 2016 ; Di Febbraro et al., 2017 ; Lima-Ribeiro & Diniz-Filho, 2013, 2017 ; Nogues-Bravo et al., 2008 ; Sandom et al., 2014). Toutefois, cette vision monolithique des interactions entre l’homme et l’environnement n’est pas rare dans les publications néo-écologiques. Elle présente un point de vue selon lequel l’humain apparaît comme étant extérieur à la nature, dans lequel la domination sur la nature est un trait commun à tous les humains. Le récent débat sur l’ancienne et la nouvelle manière de pratiquer la conservation a mis en évidence ces différences philosophiques dans la façon dont nous considérons la place de l’homme dans la nature (Doak, Bakker, Goldstein et Hale, 2014a, 2014b ; Kareiva, 2014 ; Kareiva et Marvier, 2012 ; Marvier et Kareiva, 2014 ; Miller, Soulé et Terborgh, 2014 ; Soulé, 1985). Lorsque les humains sont perçus comme fondamentalement séparés de la nature, alors la relation entre les humains et l’environnement reste inchangée, et le résultat est inévitable (ruine écologique). De ce fait, la nature doit être préservée et maintenue séparée de l’homme si l’on veut maintenir la biodiversité et minimiser la menace d’extinction. La théorie de l’overkill justifie cette perspective préservationniste [le fait de sanctuariser des territoires en créant des aires protégées en y interdisant l’accès aux ressources pour les populations locales, NdT]. »
L’Anthropocène représente à la fois potentiellement une nouvelle période géologique et une certaine perception de l’impact – presque toujours perçu implicitement ou non comme négatif – des humains sur leur environnement :
« Alors que les géoscientifiques évaluent empiriquement l’Anthropocène comme une nouvelle époque géologique potentielle, une définition plus large de l’Anthropocène, utilisée au-delà des géosciences, est devenue synonyme d’une époque où les activités anthropiques en sont venues à dominer les écosystèmes de la Terre (Autin, 2016 ; Braje & Erlandson, 2013a). Le concept a tellement capté l’imagination et l’intérêt des chercheurs qu’il a donné lieu à une pléthore d’articles récents et à plusieurs nouvelles revues consacrées à l’Anthropocène comme période d’impacts environnementaux anthropiques. Il est devenu un puissant point de ralliement interdisciplinaire autour duquel des chercheurs de diverses disciplines s’expriment comme jamais auparavant sur les questions relatives aux humains et à leur environnement (Ellis, 2018). »
La date marquant le début de l’Anthropocène varie grandement selon les chercheurs. Certains la font démarrer en 1950, d’autres avec l’industrialisation de l’Occident et l’expansion coloniale des empires, d’autres encore avec l’avènement de l’agriculture et des civilisations. Auteur d’un livre où il propose de sanctuariser 50 % de la planète, le biologiste E.O. Wilson – cité par Jean-Marc Gancille dans Carnage – dit ceci à propos des « chasseurs humains » :
« Les chasseurs humains n’aident aucune espèce. C’est une vérité générale et la clé de toute cette situation mélancolique. Alors que la vague humaine s’abattait sur les dernières terres vierges telle une couverture étouffante […], les humains n’étaient limités ni par la connaissance de l’endémicité ni par une quelconque éthique de la conservation. »
Cette vision extrêmement simplificatrice de l’espèce humaine néglige le fait que ses impacts variaient de manière significative à travers les époques et selon les contextes.
« Prolonger l’Anthropocène dans le temps ne tient pas compte non plus des facteurs réels qui rendent les impacts anthropogéniques modernes particulièrement destructeurs – la combinaison d’une population en croissance exponentielle, de techniques d’extraction efficaces et destructrices, d’une consommation massive, d’innovations technologiques et d’une transmission des connaissances rapides. Si l’homme a toujours été destructeur, l’étude du passé historique ou préhistorique ne permet pas non plus de comprendre comment certaines cultures ont pu atténuer leurs impacts, ni dans quels contextes ceux-ci ont été exacerbés, ni à quoi pouvaient ressembler les points de basculement. »
Le terme d’Anthropocène est aussi questionnable, car chaque espèce, d’une manière ou d’une autre, interagit et laisse sa trace sur le paysage. Certaines plus que d’autres. Par exemple, les castors et les éléphants sont considérés comme des espèces ingénieures en raison des profondes modifications de l’environnement qu’ils laissent dans leur sillage. Ils créent des niches écologiques pour d’autres espèces et contribuent à augmenter la diversité biologique du milieu. L’espèce humaine modifie les paysages de manière similaire depuis des centaines de milliers d’années, par exemple en utilisant le feu qui stimule la germination de nombreuses espèces de plantes. La maîtrise du feu acquise au fil des générations par les peuples autochtones leur permettait de prévenir les méga-incendies qui sévissent aujourd’hui. Ces derniers ne proviennent pas seulement du changement climatique, ils ont aussi pour origine la suppression des techniques paysagères autochtones un peu partout dans le monde[iii].
« En plus des impacts humains immuables dans le temps, la diversité interculturelle dans les interactions humaines avec l’environnement est également ignorée. La diversité des connaissances écologiques locales des personnes dans toutes les régions du monde et à travers toutes les époques doit être considérée comme uniforme. Les impacts anthropiques sont souvent structurés de façon binaire. Soit ils sont intrinsèquement destructeurs, soit ils sont le fait de « nobles sauvages » vivant complètement en harmonie avec la nature (par exemple, Penn & Mysterud, 2017:3).
[…]
Lorsque les interactions entre l’homme et l’environnement sont considérées comme fixes et immuables, l’étude de la résilience et des pratiques durables des peuples modernes ne peut offrir aucune solution. Cependant, comme tout autre organisme, l’homme peut détruire, modifier, améliorer ou préserver selon le contexte. Et il existe un vaste continuum d’interactions entre l’homme et l’environnement qui va de l’extinction à la coexistence durable (Anderson, 2010 ; Turner & Berkes, 2006 ; Rick et al., 2016 ; Wolverton, Nolan et Ahmed 2014). »
Le biologiste John Terborgh évoque lui aussi le modèle overkill :
« L’apparition bien documentée d’un overkill préhistorique en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Madagascar, en Océanie et ailleurs devrait nous faire prendre conscience que les peuples autochtones prémodernes n’ont pas toujours été des gardiens exemplaires des ressources biotiques. »
Comme on l’a vu plus haut, parler d’un overkill « bien documenté » est très discutable.
Le cas de John Terborgh est intéressant. D’après le journaliste d’investigation Mark Dowie, auteur du livre Conservation Refugees, John Terborgh souhaite par exemple le « déplacement volontaire » des habitants originels – les Indiens Matsigenka – du parc national de Manú au Pérou, pour qu’ils puissent subvenir à « leur désir de groupe indigène contacté [par la civilisation, NdT], c’est-à-dire acheter des biens de consommation et fournir une éducation à leurs enfants, et participer à l’économie marchande. » En réalité, Terborgh se moque pas mal de la volonté de ces peuples. Il considère que nature et biodiversité sont un « luxe » dont les humains peuvent se passer, c’est pourquoi il propose la création d’une armée internationale afin de défendre la nature de tous les dangers humains, des idées qui lui ont valu à plusieurs reprises d’être traité d’ « écofasciste ». En un sens, Terborgh n’a pas tout à fait tort, car les humains du monde industriel ne dépendent plus depuis bien longtemps des services écosystémiques pour assurer leur subsistance, mais ceci est une réalité pour une partie seulement de l’humanité.
Selon la Banque mondiale, 80 % de la biodiversité mondiale restante se concentre sur 25 % de la surface terrestre, des terres gérées et utilisées par des peuples indigènes représentant 476 millions de personnes. Ces peuples représentent l’écrasante majorité de la diversité culturelle, par conséquent il existe un lien indéniable entre diversité biologique et diversité culturelle. Ces chiffres n’apparaissent à aucun moment dans le livre de Jean-Marc Gancille, mais cela ne l’empêche pas de déclarer que « l’homme a fait largement la preuve de son incapacité à protéger l’environnement ». Quel mépris pour ces centaines de millions de personnes, pour les Kayapos, tribu de l’Amazonie brésilienne engagée depuis 500 ans dans une lutte à mort afin de protéger un bout de forêt contre l’expansion de la civilisation occidentale.
Ce que John Terborgh, E.O. Wilson et Jean-Marc Gancille proposent, cela porte un nom : un génocide culturel, ou un génocide tout court. Privées de leurs terres ancestrales et rendues dépendantes de l’économie marchande, les populations autochtones sombrent presque toujours dans une spirale infernale et dévastatrice – famines, prostitution, Sida et maladies, alcoolisme, extrême pauvreté et addiction aux drogues les déciment doucement mais sûrement. Et les terres libérées par ces communautés sont ensuite exploitées par l’industrie touristique ou par les industries extractives (les cas d’aires protégées déclassées ne manquent pas). S’en suivent bien souvent une augmentation du braconnage et de la déforestation dans les forêts vidées de leurs habitants, c’est le constat fait notamment par Mark Dowie dans son enquête. L’exploitation touristique menace déjà les parcs nationaux aux États-Unis, en Afrique également. Sanctuariser la nature est une impasse, ça ne fonctionne pas. Mais les organisations de la conservation s’obstinent dans cette voie depuis un siècle, sans succès.
Cela n’empêche pas Gancille de déclarer, sans vraiment développer la question sociale ni l’aspect santé (on peut manger de la viande et être en bonne santé), tout en prenant soin de disséminer au fil des pages quelques citations de philosophes à la noix pour appâter le bourgeois progressiste, que :
« Aujourd’hui écologie, cause animale, justice sociale et santé convergent. »
Parler de justice sociale alors que les antispécistes mettent au même niveau les éleveurs paysans et l’élevage industriel, c’est se moquer du monde. La paysannerie était la première à dénoncer l’industrialisation de l’agriculture. Sur les réseaux sociaux comme dans la rue, les animalistes ciblent les artisans bouchers et l’élevage paysan. Il est vrai qu’aller mettre le bordel chez la grande distribution, c’est prendre le risque de se frotter au service de sécurité. Les animalistes privilégient donc les cibles faciles, déjà très affaiblies. Quel courage, quel sens de l’honneur.
Attaquer les agriculteurs sur le plan moral et les lyncher en public, mettre le feu à leurs installations, alors que la profession est en grande difficulté et que 370 agriculteurs se suicident chaque année, c’est indigne et lâche, antisocial au possible. Le collectif PARIAS (Paysans anéantis et ruinés par l’idéologie animaliste et son système) explique par exemple que la maltraitance animale est de plus en plus invoquée par les autorités pour harceler et persécuter les petits éleveurs. Les saisies d’animaux augmentent dans les élevages en plein air à cause des animalistes, une hérésie pour le bien-être animal.
Dans une tribune publiée sur le blog de Mediapart, voici ce que raconte le collectif PARIAS :
« Les concepts de maltraitance et de bien-être animal, portés par les «défenseurs» des animaux, par les administrations agricoles et désormais par les industriels, fabriquent un système pervers à l’opposé de la connaissance des animaux et du bon sens le plus élémentaire.
Ainsi, on a pu voir des vaches saisies et froidement abattues pour défaut d’identification, pour absence d’abreuvoir alors que les vaches buvaient à la rivière, pour des maigreurs liées à l’âge des bêtes malgré une nourriture abondante, etc…
Les saisies d’animaux, d’une violence inédite, sont généralement suivies de procès tout aussi accablants qui laissent les éleveurs ruinés, financièrement, socialement et moralement. Ces horreurs se banalisent au rythme de l’intérêt croissant que portent les médias sur la condition animale et de l’influence grandissante des associations défendant la Cause animale.
[…]
Nous voilà donc accusés de « maltraitance » quand nos bêtes se trouvent tachées de boue, paissent sous la pluie, perdent du poids pendant l’hiver. La maigreur, les maladies, sont désormais des signes de pratiques indignes indépendamment de la prise en compte de l’âge de l’animal et des soins qu’apportent les éleveurs pour y remédier. Le choc des images propage le mépris et la haine sur les réseaux sociaux à une vitesse inversement proportionnelle à la patience qu’il nous faut pour soigner nos bêtes.
Au fur et à mesure que la population intègre le mode de vie urbanisé, le lien à la terre et aux animaux se perd et la sensibilité se transforme. Quand le modèle du « bien-être » devient le chat de salon et la vache hors-sol élevée en stabulation chauffée, sur logette matelassée et avec air filtré, massée et traite par des robots, de quelle vie animale est-il donc question? Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est au développement d’une idéologie basée sur des affects, des sensibleries n’ayant pas de fondements rationnels et se manifestant par un transfert anthropomorphique de nos besoins d’humains vers ceux des animaux. »
La présentation tronquée de Gancille travestit la réalité afin de poursuivre un but politique, au mépris des données scientifiques, des droits des peuples autochtones et des paysans, les mêmes communautés déjà persécutées depuis des siècles par le système capitaliste.
Il était important pour moi de revenir longuement dans cette première partie sur ce prétendu « blitzkrieg » du Pléistocène, car Arte avait diffusé un documentaire (que je ne retrouve plus) présentant la même version simplifiée de l’histoire humaine. On voit donc à quel point cette doctrine politique aux fondations scientifiques très incertaines s’impose au grand public.
Imaginez la réaction d’un enfant apprenant que son espèce est une anomalie, une sorte de cancer décimant les animaux depuis au moins 100 000 ans. À peine sorti du ventre de sa mère, on lui balance à la figure qu’il fait partie des nuisibles, chose qui risque presque certainement de laisser des traces, voire un traumatisme psychologique. Cet enfant, va-t-il se passionner pour la nature ou plutôt s’en désintéresser totalement ? Adoptera-t-il des comportements écologiques, voudra-t-il travailler à défendre la biodiversité ? On peut sérieusement douter des bénéfices à long terme d’une telle doctrine sur la santé mentale des humains civilisés et, par effet rebond, sur les écosystèmes naturels.
Incohérences multiples
Nombreuses sont les incohérences dans Carnage, j’en ai relevé seulement quelques-unes. Dans le chapitre sur les sacrifices, l’auteur évoque « des barbaries issues d’anciens cultes païens » pour ensuite, quelques pages plus loin, parler des parcs zoologiques comme servant de vitrine « à la puissance des nations impérialistes triomphant de la « sauvagerie » du monde non-occidental. » Plutôt ironique sachant que le livre donne l’impression au lecteur que l’antispécisme, ce merveilleux progrès moral enfanté par la civilisation occidental, doit triompher de la « barbarie » des mangeurs de viande partout sur Terre. Claude Lévi-Strauss mentionnait à juste titre dans Race et Histoire que « le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie. »
Gancille oppose la domestication et l’idée d’une domination du vivant imposée par la civilisation au « pacte » établi entre les chasseurs-cueilleurs et les animaux, notamment en donnant une brève description de l’apprivoisement d’animaux sauvages par ces derniers. Les chasseurs-cueilleurs, qui nous étaient présentés au début du livre comme des exterminateurs d’espèces pratiquant systématiquement l’overkill depuis des millénaires, retrouvent soudainement grâce aux yeux de Gancille.
Plus loin dans le livre, au sujet des zoos :
« Condamnés à l’emprisonnement sans être coupables, soumis à une vie misérable, les animaux captifs deviennent littéralement fous. »
Gancille figure parmi les fondateurs du collectif Rewild[iv] et milite ardemment pour la libération des animaux « fous » emprisonnés dans les zoos. Une position tout à fait cohérente, vous en conviendrez. La plupart des animaux élevés en captivité survivent difficilement lors de leur réintroduction, il leur manque la culture du milieu. En effet, les groupes d’animaux sauvages se transmettent de génération en génération un savoir unique et lié à l’endroit où ils vivent. L’écologue Carl Safina en parle longuement dans un podcast (en anglais) sur Mongabay[v]. Sans cette culture, ils survivent très difficilement.
Par exemple, pour les carnivores nés en captivité puis relâchés, le taux de survie s’élève à seulement 33 % d’après une étude publiée dans Biological Conservation en 2008 :
« Les animaux en captivité n’ont généralement pas les comportements naturels nécessaires pour réussir dans la nature. […] Leur manque de compétences en matière de chasse et leur absence de peur envers les humains sont des inconvénients majeurs[vi]. »
Les animaux nés et élevés en captivité au contact des humains ont tendance à s’en approcher dangereusement une fois relâchés, et dans un environnement civilisé, un carnivore sauvage a toutes les chances de se faire massacrer au fusil ou de finir écrasé par une voiture. Loin de moi l’idée de défendre les zoos, je hais ces endroits et souhaite les voir disparaître, tout comme Gancille. Mais l’impact direct des zoos sur la biodiversité est minime. Le sujet occupe bien trop de place dans l’espace médiatique et sert de diversion pour éviter de parler des sujets qui fâchent, comme la remise en question de la croissance économique présentée par les scientifiques comme incompatible avec la conservation de la nature[vii]. Le marché des animaux de compagnie[viii] exotiques est quant à lui en pleine croissance au niveau mondial, et les volumes d’animaux prélevés dans la nature pour satisfaire la demande dépassent selon toute probabilité ceux des zoos.
Au sujet de la chasse, Gancille dénonce l’élevage en masse d’animaux destinés à être relâchés pour être abattus, des individus incapables de survivre dans la nature selon ses dires. Là encore, on a du mal à percevoir la cohérence avec le projet Rewild qui souhaite relâcher des animaux de zoos élevés en captivité.
Gancille, en bon champion du sophisme, déclare également ceci :
« Quel que soient son niveau de vie et son mode de consommation, l’homme occupe des espaces naturels autrefois habités par la grande faune sauvage. »
Cette assertion contredit encore une fois le début du livre. Comment les chasseurs-cueilleurs préhistoriques auraient-ils pu massacrer la mégafaune du Pléistocène sans coloniser l’ensemble des terres et donc occuper déjà il y a plusieurs dizaines de milliers d’années les mêmes espaces ? Cela n’est pas sérieux et ne tient pas debout. On retrouve aussi à travers ces propos ce mythe de l’Éden largement dénoncé depuis des années par William Cronon[ix], et plus récemment par un autre historien de l’environnement, Guillaume Blanc[x]. Stephen Corry, directeur de l’organisation de défense des peuples autochtones Survival International[xi], combat également avec véhémence cette vision ignorant totalement la présence des peuples autochtones sur ces territoires présentés comme vierges et inoccupés.
Durant tout le livre, Gancille, qui ignore – délibérément ou non – la diversité culturelle, concentre son propos sur les pratiques et les croyances existant au sein de sa propre culture. Il parle de l’élevage tel qu’il existe au sein de la civilisation occidentale, ce qui lui permet de dire « les pâturages empiètent sur les écosystèmes sauvages ». Pourtant, les agro-pasteurs Maasaï parcourent les plaines de l’Afrique de l’est depuis des temps immémoriaux, et leur bétail partage les pâturages avec zèbres, rhinocéros, gnous, buffles et d’innombrables espèces d’antilopes. Au Kenya, la réserve communautaire de Nashulai cherche à réinstaurer ces pratiques traditionnelles qui rendaient la coexistence possible entre humains et faune sauvage[xii].
Preuve que la tyrannie du carbone se met doucement en place, Gancille martèle sans cesse des chiffres sur les émissions de CO2 liées à l’élevage et au régime omnivore. À la limite, peu importe si des communautés humaines vivent depuis des millénaires de l’élevage sans ruiner la planète, il faut détruire leur culture et leur mode de vie afin de les soumettre à la civilisation antispéciste.
Comme j’ai tenté de le démontrer dans des publications antérieures, la démocratisation du végétarisme a toutes les chances de ne rien changer à la déforestation[xiii]. D’autre part, la cause animale et l’antispécisme apparaissent à l’évidence comme le cheval de Troie idéologique de la révolution biotechnologique en cours[xiv]. Je ne reviendrai donc pas sur ces points ici.
Gancille colporte les poncifs habituels de l’écologisme dominant sur une prétendue interdépendance entre les humains du monde civilisé et les espèces vivantes. Or, comme l’a démontré le chercheur R. David Simpson après plus de 25 ans à étudier les relations entre économie et services écosystémiques, cette interdépendance disparaît avec le développement de la civilisation[xv]. Les services dits « naturels » ont tendance à être remplacés par des services artificiels au fur et à mesure que la densité démographique augmente. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est plus efficace, économiquement parlant, mais aussi sur le plan sanitaire, de collecter les déchets organiques (excréments et restes alimentaires) puis de les traiter dans des usines que de les abandonner dans les espaces naturels. Les écosystèmes locaux seraient probablement incapables d’absorber les déchets organiques produits par une ville de plusieurs dizaines de milliers d’habitants, alors une mégalopole… À tous les niveaux, le fonctionnement d’une ville ne repose en rien sur d’hypothétiques « services » de la nature, mais sur des infrastructures industrielles alimentées en énergie produite elle aussi en quantité industrielle. C’est vrai pour la production et le transport de la nourriture, de l’eau potable et le traitement des eaux usées comme des déchets dans les villes modernes.
Certaines phrases trahissent la vision idéalisée qu’a Gancille de ce qu’il appelle les « démocraties occidentales » :
« Tous les êtres humains sont en effet égaux devant la loi et ont des droits fondamentaux qui les protègent contre la torture, la mise à mort et l’asservissement, en tous cas dans la plupart des démocraties occidentales. »
Comment peut-on affirmer, au vu des persécutions que subissent les populations autochtones au Canada, aux États-Unis et en Australie depuis des siècles, au vu de la répression croissante en France depuis plusieurs années, que les régimes politiques des États occidentaux sont des démocraties ? Une aristocratie élective n’a rien d’une démocratie, et pour le comprendre, il faut lire Francis Dupui-Déri ou visionner sur Youtube un de ses cours à l’université de Québec-Montréal[xvi].
Alors que Gancille appelait plus ou moins explicitement à la révolte dans Ne plus se mentir, dans Carnage il invoque le pouvoir de la puissance publique pour interdire les zoos, abolir l’élevage et lancer une transition vers l’agriculture végétalienne pour nourrir le monde. En effet, on voit mal comment imposer la dictature antispéciste sans la force coercitive de l’État. On pourrait discuter également de la pertinence économique de l’agriculture végétalienne face aux biotechnologies dans le cadre du système capitaliste. En observant les mouvements de capitaux, il est évident que les biotechnologies l’emporteront.
Gancille a beau se défendre de ne pas être un « idiot utile du capitalisme », il participe sans le vouloir au développement de la nouvelle industrie des substituts végétaux.
« Les végétariens et végétaliens se contentent généralement de produits locaux, bio et non transformés et ne recherchent pas des produits ressemblant à de la viande qu’ils abhorrent. En revanche, il existe un véritable marché de la simili-viande qu’alimente la culpabilité des omnivores en dissonance cognitive. »
Même si 90 % des alternatives à la viande ne sont pas consommées par des végétariens ou des végétaliens, les campagnes des associations comme L214, largement relayées par les médias de masse, participent violemment et activement à culpabiliser les individus alors que ces derniers possèdent un pouvoir limité sur le contenu de leur assiette. À ma connaissance, l’emploi massif de pesticides n’a jamais été soumis à un vote. Au cours du XXe siècle, la production de viande n’a cessé d’augmenter avec le progrès technique et, pour éviter une crise de surproduction, le marketing agressif de l’industrie agroalimentaire s’est chargé de stimuler la demande. Les consommateurs sont comme pris dans un étau entre les campagnes marketing de deux industries.
Précisons que L214 participe activement au développement de l’industrie des substituts à la viande, notamment en incitant les fast-foods à proposer ce type de produits sur leur carte[xvii] ou encore en faisant de la publicité pour l’entreprise Beyond Meat[xviii]. Cela n’empêche bien entendu pas Gancille de relayer très régulièrement les tweets de L214.
L’auteur de Carnage a pris le soin de disséminer quelques perles au fil des pages, et je l’en remercie. Il me facilite le travail pour discréditer son propos. Par exemple, pour justifier une alimentation strictement végétale :
« Il suffit de constater la force d’autres grands mammifères exclusivement herbivores comme le gorille, l’éléphant ou le rhinocéros pour se convaincre que le caractère énergétique de la viande est plus que contestable. »
Sauf qu’un gorille adulte peut consommer 18 kg de nourriture par jour et un éléphant plus de 130 kg[xix]. Il est bien connu que les herbivores, contrairement aux carnivores, doivent passer une grande partie de leur temps à s’alimenter pour subvenir à leurs besoins énergétiques.
Pour appuyer son raisonnement douteux et culpabiliser son audience, Gancille martèle un autre sophisme :
« En tant qu’êtres humains, nous sommes omnivores, ce qui signifie que nous avons le choix de notre alimentation. »
Voici comment Wikipédia définit le fait d’être omnivore sur le plan biologique :
« Une espèce est dite omnivore — du latin omni (tout) et vorare (manger, avaler) — quand son appareil digestif lui permet d’absorber des aliments d’origines végétale et animale. Cette caractéristique permet aux espèces omnivores d’adopter une alimentation « opportuniste », variable en fonction de la disponibilité des aliments.
Le régime omnivore est un régime alimentaire, plus ou moins opportuniste, qui facilite l’adaptation et la survie de l’espèce, avec des tendances variables selon les espèces, les lieux, les saisons ou les individus. »
La caractéristique principale d’un omnivore, qui se retrouve par exemple chez de nombreux peuples autochtones, est de manger une très grande diversité d’aliments. Cette stratégie a notamment l’avantage de ne pas surexploiter l’écosystème environnant en répartissant les prélèvements de la chasse et de la cueillette sur une variété importante d’espèces.
Être omnivore n’a donc pas grand-chose à voir avec une question de choix mais plutôt avec une question d’adaptation au milieu naturel dans lequel on évolue. Quand vous dépendez vraiment des écosystèmes environnants, vous chassez des espèces animales et récoltez des végétaux évoluant dans le même milieu, et/ou vous cultivez ce qui pousse à chaque saison en fonction de différents facteurs (terre, climat, humidité, etc.), et/ou vous élevez des bêtes adaptées au climat et à l’environnement locaux. C’est cela vivre écologiquement, dans le cadre des limites de la nature, et cela ne pourra être possible que lorsque la propriété privée et le capitalisme auront été éradiqués, lorsque le système technologique aura été démantelé. Choisir un régime alimentaire en fonction d’une philosophie de vie déconnectée de la réalité du milieu dans lequel vous vivez n’a par conséquent rien d’écologique, d’autant plus si la civilisation industrielle capitaliste reste en place pour rendre ce choix consumériste possible. Présentée comme la voie à sens unique du progrès, cette injonction à choisir un régime alimentaire végétarien ou végétalien s’apparente à un caprice de consommateur occidental bien nourri, une énième fantaisie de la bourgeoisie urbaine progressiste. En outre, le matraquage autoritaire des antispécistes fait fi de la diversité des individus au sein de la population humaine. Certaines personnes supportent bien un régime végétalien, d’autres pas du tout. Pour finir sur ce point, le régime végétalien oblige ses adeptes à se complémenter à vie en vitamine B12. Difficile de faire plus artificiel et éloigné de la nature comme régime alimentaire.
Vers la fin du livre, l’auteur cite Claude Lévi-Strauss :
« Si l’humanité devenait intégralement végétarienne, les surfaces aujourd’hui cultivées pourraient nourrir une population doublée. »
Comment peut-il être souhaitable de voir la population humaine doubler sur cette planète ? Sur les plans écologique et démocratique, c’est un non-sens absolu. En revanche, l’économie mondiale a constamment besoin de nouveaux consommateurs et d’esclaves-salariés pour continuer à croître. Jeff Bezos souhaite voir la population continuer à croître sur cette planète, c’est peut-être pour cette raison qu’il investit dans les startups véganes[xx].
Dans la même veine, Gancille, qui n’est plus à une contradiction près, écrit qu’ « un monde végan pourrait de surcroît être profitable à l’emploi. » Après avoir dénoncé la croissance de la population humaine, le capitalisme, les échanges commerciaux et les catastrophes écologiques qui s’en sont suivies, il fallait oser. Gancille cite par exemple le rapport Afterres 2050 indiquant que 125 000 emplois pourraient être créés en France en divisant par deux la production animale. L’antispécisme, ou comment rendre le capitalisme résilient, un projet fabuleux méritant qu’on s’y attèle tous dans la joie et la bonne humeur.
La divergence entre écologie et antispécisme est également abordée dans Carnage :
« Elle s’explique notamment par une relation différente au règne animal. Là où les animalistes se préoccupent des individus, les écologistes pensent « espèces ». Pour les uns, prime la sensibilité des bêtes, pour les autres les équilibres des écosystèmes. Et derrière ces différences d’approche surgit toujours la question de la toute-puissance humaine. »
On retrouve tout au long du livre ce même aplomb et la même arrogance pour asséner de fausses vérités. La toute-puissance humaine caractérise essentiellement la culture du monde civilisé, pas toute l’humanité. Comme le raconte l’anthropologue Philippe Descola[xxi], les Achuar d’Amazonie se considèrent comme appartenant à la même communauté que les animaux sauvages. Ce schéma se retrouve chez les peuples de la forêt du bassin du Congo, chez les chasseurs-cueilleurs San d’Afrique australe[xxii], ou encore chez les Gimi de Papouasie-Nouvelle-Guinée[xxiii]. Le langage donne des indices sur la perception du monde qu’ont les membres de ces différentes cultures non-civilisées ; il n’existe souvent pas de traduction dans leur langue pour les mots « nature » ou « contrée sauvage ». Pour eux, il n’existe pas de fracture entre nature et culture. C’est probablement là que se situe le problème fondamental et insoluble avec la civilisation, et non avec l’espèce humaine.
Parfois, on se demande comment Gancille peut croire ce qu’il écrit :
« Cesser toute exploitation animale en considérant chaque individu au titre de sa valeur intrinsèque et de son droit à la vie contribuera incontestablement à restaurer les fonctionnalités écologiques vitales pour tous les habitants de cette planète. »
Ubuesque. Il faut vraiment croire au Père Noël ou être complètement ignorant du fonctionnement de l’économie mondialisée (effets rebonds, compétition exacerbée, etc.) pour croire à un scénario aussi simpliste. D’abord, on voit mal comment cesser du jour au lendemain toute exploitation animale étant donné que le capitalisme repose entièrement sur l’exploitation des êtres vivants humains et non-humains. Gancille semble oublier que chaque être vivant est considéré comme une « ressource » au sein de la société moderne capitaliste. Les animalistes célèbrent les sanctuaires pour animaux tout en exigeant la libération animale, position incohérente au possible puisque les animaux y sont retenus captifs. Par ailleurs, ces sanctuaires doivent générer des fonds pour payer leurs installations et leurs salariés. Comment y parviennent-ils ? En menant des campagnes de communication instrumentalisant les animaux sur les réseaux (a)sociaux, en jouant sur la corde sensible pour que l’audience crache le pognon. Comment ne pas voir cela comme une autre forme d’exploitation animale ?
Un autre élément m’a interpelé dans les deux citations précédentes, c’est le mot « individu » opposé à l’espèce, à la santé des écosystèmes. Découlant probablement du concept de sentience devenu central pour la plupart des antispécistes, cette préoccupation de l’individu animal rappelle une doctrine hégémonique depuis maintenant deux siècles : le libéralisme économique. L’intérêt égoïste de l’individu placé au centre des préoccupations et, de préférence au-dessus de tout le reste – des limites écologiques comme du bien-être de la communauté. Chaque jour, on récolte les fruits de ce progrès. La société s’est fragmentée comme jamais auparavant, le tissu social et la famille ont volé en éclats, l’empathie est en chute libre en raison du développement technologique[xxiv], dépressions et maladies mentales explosent[xxv], etc. L’antispécisme, c’est une évolution du néolibéralisme, une modification cosmétique variant la manière dont sont intégrés les animaux à l’économie marchande. Leur statut et la nature de leur exploitation changeront très certainement. Le système législatif leur attribuera un statut juridique différent, ainsi émergera une nouvelle ressource exploitable pour les capitalistes.
Inutile d’avoir une imagination débordante pour anticiper les nouveaux marchés qui vont émerger grâce à ce que les antispécistes désignent de manière trompeuse par la libération animale. Les réseaux sociaux regorgent d’exemples de vidéos d’animaux de ferme désormais traités comme des animaux de compagnie, un marché en pleine expansion au niveau mondial[xxvi]. Des relations avec les animaux qui se substituent peu à peu aux relations sociales humaines puisque les êtres humains, invités depuis leur plus jeune âge à se soucier uniquement d’eux-mêmes, atteints d’un narcissisme pathologique conséquence de leur addiction aux réseaux sociaux, ont été privés de leur capacité naturelle à vivre en communauté. Cette obsession maladive visant à placer l’individu au centre de toutes les attentions ne peut coexister avec la démocratie, encore moins avec l’écologie. Thomas Lepeltier, un autre antispéciste notoire, prétend dans un texte publié par la revue antispéciste L’Amorce que l’écologie va tuer l’antispécisme[xxvii]. J’aurais plutôt tendance à dire, au vu de l’état de la biosphère, ainsi qu’en observant les mutations de l’industrie agroalimentaire pour évoluer vers une société technovégane[xxviii], que l’antispécisme est l’ennemi de l’écologie.
[i] https://prix-animalisme-francophone.com/2020-2/
[ii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6202698/
[iii] https://e360.yale.edu/features/our-burning-planet-why-we-must-learn-to-live-with-fire
[iv] https://www.rewild.ong/les-fondateurs/
[v] https://news.mongabay.com/2020/06/podcast-animals-have-culture-too-and-for-some-its-crucial-to-their-survival-and-conservation/
[vi] https://www.nationalgeographic.com/animals/2008/01/predators-captivity-habitat-animals/
[vii] https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/perte-de-biodiversite-et-croissance-economique-quelles-politiques
[viii] https://greenwashingeconomy.com/animaux-de-compagnie-machine-a-fric-desastre-ecologique/
[ix] https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2009-1-page-173.htm
[x] https://theconversation.com/debat-colonialisme-vert-une-verite-qui-derange-146966
[xi] https://www.theelephant.info/culture/2019/04/11/noble-savages-and-other-myths-what-indigenous-people-can-teach-us-about-biodiversity/
[xii] https://www.nashulai.com/model
[xiii] https://greenwashingeconomy.com/manger-vegetarien-ne-stoppera-pas-la-deforestation/
[xiv] https://greenwashingeconomy.com/lavenir-sera-vegan-que-ca-vous-plaise-ou-non/
[xv] https://thebreakthrough.org/journal/no-9-summer-2018/the-trouble-with-ecosystem-services#_edn4
[xvi] https://www.youtube.com/watch?v=AJrdu0r6X90&t=1525s&ab_channel=J-F.VEILLEUX
[xvii] https://www.l214.com/communiques/2020/06/11-enquete-burger-vegan/
[xviii] https://m.facebook.com/l214.animaux/posts/10158335586989757
[xix] https://www.awf.org/wildlife-conservation/elephant
https://www.awf.org/wildlife-conservation/mountain-gorilla
[xx] https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/case-study/milliardaires-investissements-vegan/
[xxi] https://www.erudit.org/fr/revues/as/2015-v39-n1-2-as01900/1030849ar/
[xxii] https://medium.com/@greenwashingeconomy/les-san-et-l%C3%A9land-25f61c21ad59
[xxiii] https://thereader.mitpress.mit.edu/the-myth-of-a-wilderness-without-humans/
[xxiv] https://theconversation.com/students-less-focused-empathetic-and-active-than-before-technology-may-be-to-blame-136249
[xxv] https://greenwashingeconomy.com/les-pays-heureux-se-cament-au-prozac/
[xxvi] https://greenwashingeconomy.com/animaux-de-compagnie-machine-a-fric-desastre-ecologique/
[xxvii] https://lamorce.co/lecologie-va-t-elle-tuer-lantispecisme/
[xxviii] https://www.ft.com/content/4ec549bc-afb7-4047-a49f-533c53837e7b





