
Les Soulèvements de la terre contre la planification écologique
« Sur le fond, nous ne croyons pas à la possibilité d’un réformisme écologique (ou social), c’est-à-dire d’un changement graduel qui amènerait progressivement vers un monde où la production des biens nécessaires à la vie ne détruit pas ses conditions. »
– Les Soulèvements de la terre
J’ai reproduit un extrait du manifeste Premières secousses des Soulèvements de la terre paru la semaine dernière aux éditions La fabrique. Dans ce passage, les Soulèvements démontent trois solutions habituellement avancées par les écologistes de gauche :
- La planification écologique ou planification de la décroissance défendue par les représentants de l’éco-technocratie et l’intelligentsia de gauche en panique totale à l’idée de voir le système industriel s’effondrer brutalement ;
- Le léninisme vert ou néo-léninisme de l’universitaire suédois Andreas Malm ou encore de l’économiste et philosophe français Frédéric Lordon ;
- L’idée, en vogue chez les colibristes, qu’il suffirait de multiplier les ZAD et les initiatives locales pour abattre le système.
Dans un article précédent, j’exposais la nuisance étatique en me basant sur le dernier livre de l’activiste Peter Gelderloos. Le discours technocratique selon lequel l’État aurait la capacité de reprendre le contrôle d’un emballement dont il est à l’origine est invalidé par plusieurs millénaires d’histoire des sociétés à État. Depuis son apparition, la machine étatique broie la vie et entrave l’évolution, c’est pourquoi notre devoir est de l’éliminer de façon rapide et définitive.
Cela dit, si je partage ce qui est écrit dans l’extrait ci-après, je ne peux pas en dire autant du reste de l’analyse des Soulèvements qui manque de structure, de pragmatisme, d’un objectif clair et d’une vision stratégique. À cela s’ajoutent une critique de la technologie plutôt médiocre (voire inexistante), les éternels poncifs marxistes de réappropriation des infrastructures industrielles, ou encore une soumission idéologique à la gauche intersectionnelle et identitaire qui éloigne/détruit les révolutionnaires potentiels. Bref, si vous attendez avec impatience un vrai livre de stratégie pour une révolution écologique, optez plutôt pour Révolution Anti-Tech. Pourquoi et comment ? de Theodore Kaczynski.
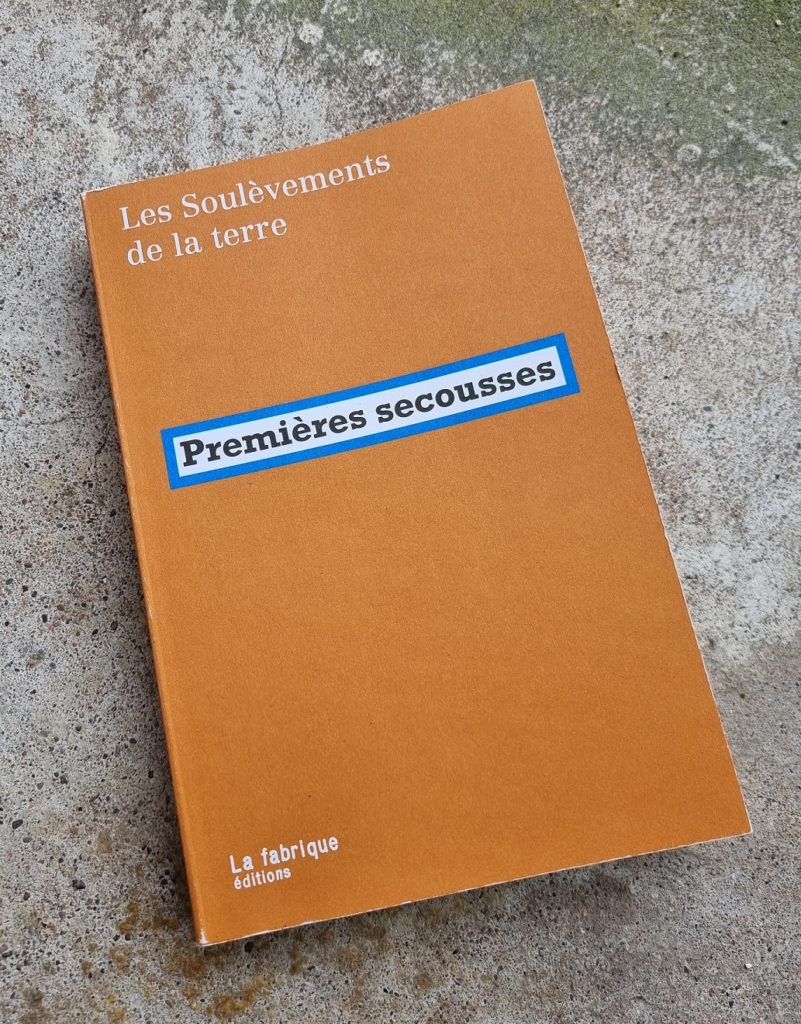
« Les peuples veulent la chute du régime »
Quand parle d’écologie, de politique, et plus encore d’écologie politique, il est difficile de se défaire du sentiment que le problème est trop gros pour nous. Devant la complexité de la machinerie socioéconomique contemporaine, l’imagination souvent capitule. Les transformations nécessaires sont structurelles – une réorganisation fondamentale de nos manières de nous nourrir, de nous loger, de nous déplacer, de nous rapporter les un.es aux autres. À cette échelle, on se heurte à l’inertie collective comme aux intérêts des possédants. Des brillants technocrates partisans de la planification écologique[1] aux néo-léninistes verts[2] prônant la prise du pouvoir, tous s’accordent pour ces raisons à dire que l’État est le seul acteur à la hauteur de l’urgence. Surtout, nous croyons que le sentiment d’impuissance fait partie du problème. C’est lui, tout autant que nos adversaires, qu’il faut combattre. Le petit sourire de supériorité intellectuelle devant la naïveté de l’auto-organisation populaire, qui traduit le manque de confiance en nos propres capacités : voilà ce que les secousses des mouvements réels peuvent transformer en grimace.
Cette défiance commune envers l’État vient cependant d’histoires politiques très différentes.
Certain.es d’entre nous, animé.es par un réformisme sincère, éprouvent ou ont éprouvé de l’intérieur les limites des possibles institutionnels. Dans un syndicat, un parti politique ou une organisation non gouvernementale, on se bat pour des mesures capables de changer concrètement et massivement le quotidien – l’interdiction des pesticides, l’augmentation des aides à l’installation, la levée des taxes sur les produits de première nécessité, l’interdiction du financement pétrolifère par les banques européennes, etc. Mais dans le monde tel qu’il est, et dans l’état actuel du rapport de force, on s’y heurte trop souvent au mur du réalisme politique. Sans un bouleversement du cadre, de telles mesures ne seront jamais « écologiquement viables » – aucun État, dont le fonctionnement dépend du marché, ne se risquera à les mettre en place.
D’autres s’inscrivent plutôt dans une tradition révolutionnaire qui refuse de faire de l’État le nom de la puissance collective. Ce refus de la prise du pouvoir s’ancre dans le constat de l’échec historique des communismes d’État, mais il plonge en réalité ses racines dans les nombreuses dissidences du mouvement ouvrier, des conseils de Bavière en 1919 aux communes aragonaises ou aux usines occupées de 36, en passant par l’autonomie italienne des années 1970. Il se nourrit également d’exemples plus récents qui ont vu les réformateurs au pouvoir vaincus par les mesures de rétorsion économiques, Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce pour les plus proches de nous. La vitalité politique contemporaine serait plutôt du côté des soulèvements populaires auto-organisés qui bousculent le champ politique aux quatre coins du globe.
Il faut pourtant constater que, dans un contexte d’effondrement de l’horizon révolutionnaire et de mondialisation économique, les mouvements qui réclament des changements par le bas semblent eux aussi échouer à arracher des victoires conséquentes, ou des victoires tout court. Pour ne prendre que les exemples les plus récents, aux États-Unis le plus grand soulèvement depuis le mouvement des droits civiques a laissé les structures racistes des forces de police inchangées. En Iran, une révolution nourrie par des aspirations féministes se fait réprimer dans le sang. En France, les mouvements sociaux qui s’enchaînent à un rythme impressionnant ne sont pas parvenus à arracher plus que de minimes concessions au gouvernement depuis la crise des subprimes en 2008. Les luttes écologiques ont bien réussi à faire abandonner quelques projets, mais elles demeurent des gouttes d’eau dans un océan de béton et de profit.
Nous voilà donc pris.es entre les mâchoires d’une tenaille qui piège quiconque s’engage dans la contestation de l’ordre existant. Entre réforme impossible et impuissance des mouvements révolutionnaires, notre rapport à l’État s’énonce sous la forme d’un problème :
Mâchoire n°1 : Les États-nation n’organisent pas la sortie du capitalisme industriel.
Mâchoire n°2 : Expérimentations, alternatives et luttes dispersées restent marginales ou échouent. Alors, que faire ?
Les Soulèvements de la terre ne sont qu’un maillon de la longue chaîne de discussions et d’expérimentations transocéaniques qui se débat avec cette question. Notre question est d’abord stratégique : comment, sur un territoire donné, accroître la capacité d’agir de ses habitant.es ? Avant d’y répondre, disons quelques mots des histoires politiques qui ont mené à la formulation de notre problème.
La social-démocratie, Lénine et la ZAD
La force de notre mouvement vient de la cohabitation en son sein d’histoires politiques distinctes. Conscient.es de l’inconséquence d’un réformisme trop sage comme de celle de la pure spontanéité révolutionnaire, nous ne sommes pas convaincu.es par les trois principales options stratégiques que propose actuellement l’écologie politique – le réformisme, le léninisme vert et l’hypothèse territoriale. Les deux premières, rejouant l’alternative classique entre réforme et révolution qui a agité le mouvement ouvrier au siècle dernier, répondent aux crises actuelles par la planification écologique. L’une pense y parvenir par voie électorale, l’autre par la voie insurrectionnelle. Toutes deux ont en commun de faire de l’État l’instrument principal de l’action politique. Elles pensent donc pouvoir échapper à la mâchoire n°1. Quant à la troisième, héritière de la politique extra-institutionnelle, parfois dite gauchiste, de tous les courants qui se tiennent à la gauche des partis communistes, elle croit en la possibilité d’un changement social par floraisons cumulées de points de résistance localisés. C’est plutôt la mâchoire n°2 qu’elle prétend surmonter. Exposons nos doutes sur ces points avant d’en explorer, humblement, une quatrième tentative.
La planification écologique peut-elle nous sauver ?
Un certain nombre d’hommes et de femmes politiques, héritier.ères du réformisme social-démocrate, présentent comme la seule solution réaliste au changement climatique la mise en place de réformes globales, à même de réguler les méfaits du capital dans le cadre existant : crédits carbone, investissements massifs dans les énergies renouvelables, taxes des énergies fossiles et des entreprises les plus polluantes, rénovation thermique des bâtiments, et même pour les plus audacieux, réforme du droit foncier. Il s’agirait, pour y arriver, d’allier conquête électorale et conversion des élites politiques et économiques à la nouvelle conscience écologique. Conjuguant vertu et sens des réalités, écologie et marchés, les partisans internationaux d’un Green New Deal entendent démonter sa possibilité à grand renfort d’analyses géopolitiques et de modèles économiques hétérodoxes. Au-delà des seuls écologistes, c’est l’ensemble des gauches qui considèrent la prise du pouvoir par les urnes comme la seule manière d’imposer aux marchés la raison d’État, qu’elle soit écologique et/ou sociale. Mais suffit-il d’avoir raison pour l’emporter ?
« L’État ne doit pas être considéré comme une entité intrinsèque, mais […] comme un rapport, plus exactement comme la condensation matérielle d’un rapport de forces entre classes et fractions de classe » Nicolas Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme, 1978
Une telle vision implique que l’État soit une structure suffisamment neutre pour être disponible à la rationalité des acteurs. Plusieurs expériences historiques nous font cependant douter de la possibilité d’un réformisme par le haut – c’est-à-dire de la possibilité pour des États de contraindre les marchés à des transformations contraires à leurs intérêts.
Le registre de « l’inaction climatique » participe de cette vision selon nous erronée. Il est faux de dire que les gouvernements ne font rien face au changement climatique. Ils accompagnent au contraire activement l’adaptation du capital aux mutations écologiques par la mise en place d’infrastructures techniques et juridiques – méga-bassines, mines de lithium, écoles d’ingénieurs, primes au moteur électrique, etc. – comme ils l’ont toujours fait en mettant en place les chemins de fers, le télégraphe, le code de l’indigénat ou de la famille, indispensables au développement de la première révolution industrielle. De même que le développement industriel a besoin d’une administration de l’espace social, l’entretien d’une classe toujours croissante d’administrateurs spécialisés, indispensables aux États-nation, a besoin du développement industriel.
Cette interdépendance vient contredire le mythe, construit par la philosophie politique et sans cesse entretenu depuis, de l’État souverain agissant au nom de la volonté générale. Le renoncement de Tsipras à mettre en œuvre les réformes conséquentes de partage des richesses pour lesquelles il avait été élu, cédant face au chantage de l’UE qui le menaçait de ne plus pouvoir payer ses fonctionnaires, en est une triste illustration. La planification écologique que beaucoup appellent de leurs vœux supposerait que les bureaucraties actuelles fassent mentir ce constat, et s’avèrent soudain capables de contraindre des acteurs économiques dont elles dépendent pour exercer leurs fonctions. Permettons-nous d’en douter.
La plus grande réussite de la social-démocratie, que ses actuels partisans ne cessent d’invoquer, est sans doute la mise en place progressive au cours du XXe siècle de ce que l’on a appelé l’État-providence – un ensemble de services publics devenus indispensables pour la quasi-totalité d’entre nous, hôpitaux, écoles, retraites, etc. Mais à quoi est dû ce succès historique ? Beaucoup s’accordent à y voir la force du mouvement ouvrier organisé, de ses actions directes et de ses potentiels succès électoraux, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale et tout au long des « trente glorieuses », dans un contexte de guerre froide et de peur du rouge. La mise en place de la Sécurité sociale doit beaucoup aux fusils des résistants communistes, qui firent préférer aux gouvernants des réformes mesurées aux turpitudes d’une révolution. Mais on oublie souvent que le déploiement des services publics est aussi une conséquence de la position dominante des États occidentaux sur le marché international jusqu’aux décolonisations. Le pillage continue des pays du Sud, l’exploitation sans limite du travail de ses habitant.es et l’absence d’industrie concurrente jusqu’au dernier quart du XXe siècle expliquent en partie les taux de croissance phénoménaux de l’après-guerre, ainsi que la possibilité de concéder ces compromis. Autrement dit, l’État-nation n’est pas le souverain absolu qu’il prétend être. Il n’est pas non plus un simple suppôt du capital. Il serait plutôt une sorte de nœud de pouvoir, qui matérialise les antagonismes sociaux en même temps qu’il s’en fait l’arbitre et les stabilise, et dont le fonctionnement dépend des marchés comme ces derniers dépendent de lui. La fabrique de l’État-providence n’est pas due à la victoire électorale de la gauche. Il nous paraît moins idéaliste de considérer qu’il a été, à un moment donné du rapport de force, dans l’intérêt des capitalistes occidentaux, de financer un ensemble de fonctions nécessaires à la reproduction de la vie sociale et de la force de travail. Ce moment est révolu. Pour différentes raisons, qui vont de la mondialisation de l’économie à l’ubérisation du travail en passant par la montée en puissance de pays du Sud et la faillite du communisme, ce rapport de force et ce qu’il a permis d’arracher ne cessent dorénavant de se dégrader.
Il est grand temps que le réalisme politique change de camp. L’idéalisme ou la naïveté nous semblent être plutôt de ceux qui croient pouvoir sortir d’une économie d’accumulation sans en briser le cadre. Même en imaginant de profonds changements dans l’opinion publique, les structures de l’État-nation, construites au cours des quatre siècles de l’âge industriel, sont plus puissantes que les bonnes volontés politiques. Malgré les tentatives de la gauche institutionnelle pour concilier fin du monde et fin du mois, une planification écologique imposée d’en haut ne peut se faire que sur le dos des pauvres, éternelles variables d’ajustement de l’économie. Des blocages en gilets jaunes aux tracteurs de 2024, ces derniers ne s’y sont pas trompés.
Léninisme vert
Cependant, nous ne croyons pas non plus que le coup de marteau qui ferait éclater le cadre en question revienne à une sorte de Léviathan[3] écologique. À ceux qui prophétisent publiquement ou qui espèrent secrètement qu’un jour viendra où la police républicaine braquera ses armes sur la tête des dirigeants de Shell ou de Monsanto, nous répondons que nous préférons croire dans une hypothèse plus souterraine qui n’a pas dit son dernier mot, celle de l’auto-organisation populaire. La proposition léniniste est portée par une frange aujourd’hui très minoritaire du champ politique, mais elle continue d’exercer sur les imaginaires une attraction non négligeable[4]. Elle s’appuie en effet sur l’exemple massif de la révolution de 1917, qui constitue un des rares cas d’une révolution socialiste victorieuse. Le léninisme vert consiste à imaginer une prise du pouvoir d’État par la force, combinée à la pression générale de la rue, pour mettre en place de manière coercitive les mesures indispensables à la survie de l’humanité – arrêt des extractions fossiles, interdiction de l’aviation privée, réorientation des industries extractives en capture du CO2, construction massive d’énergies renouvelables, etc., et, tant qu’à faire, le partage des richesses. La martiale clarté d’une telle proposition a quelque chose de séduisant, en ces temps troublés. La fin des pesticides ou des extractions fossiles, objectifs que nous partageons, ne se fera évidemment pas sans contraintes, et quoi de plus efficace qu’un appareil d’État pour les atteindre ?
Le problème, au fond, c’est que nous ne voyons pas comment l’État peut devenir un opérateur de changement réel sans se faire autoritaire. Faire de l’État l’acteur central des bouleversements révolutionnaires indispensables pour répondre aux urgences écologiques, c’est rejouer une option historique dont nous savons qu’elle peut mener au déchaînement de la violence bureaucratique la plus pure. Cette possibilité suffit selon nous à l’écarter. Nous préférons faire confiance aux promesses des soulèvements populaires plutôt qu’à celles d’une dictature éclairée, qu’elle soit verte ou rouge. Oui, le chemin est difficile. Du Chili au Soudan en passant par la tragédie syrienne, toutes les tentatives se heurtent au bras plus ou moins sanguinaire de la contre-insurrection. Mais nous devons travailler à les renforcer. Plutôt que de remettre à l’État la puissance collective, nous voulons constituer des contre-pouvoirs autonomes.
Pour être un peu plus précis.es, et malgré la finesse des analyses néo-léninistes avec qui la discussion est loin d’être terminée, l’expérience révolutionnaire du XXe siècle porte selon nous un ensemble de leçons difficilement contournables. D’abord, la dépendance économique des États ne cesse pas lorsque ses dirigeants portent le treillis plutôt que le costume. Il faut toujours payer les fonctionnaires, et en particulier les soldats, c’est-à-dire produire beaucoup et/ou séduire les investisseurs internationaux. À cet égard, nous ne voyons pas pourquoi l’écologie d’État réussirait là où le socialisme d’État a échoué, à savoir sortir d’une économie productive dans le cadre de l’État-nation. Ensuite, la proposition du léninisme vert repose sur une comparaison entre l’urgence écologique actuelle et la situation de guerre civile qui est celle de la Russie d’après 1917, et cette comparaison a de considérables limites. Ce qui est acceptable pour un peuple immédiatement menacé dans sa chair par des armées étrangères et une partie de ses classes dirigeantes ne l’est pas pour les populations mises à l’épreuve par les bouleversements écologiques, et heureusement. Enfin, affirmer qu’au nom de l’écologie on peut légitimement outrepasser les fragiles paravents qui contiennent la puissance souveraine dans les régimes parlementaires, c’est balayer beaucoup trop négligemment la mémoire des totalitarismes. Si l’option léniniste est loin d’être la plus menaçante, d’autres – éco-fascismes ou libéralismes autoritaires – peuvent tirer parti d’une rhétorique qui fait de l’État la seule instance capable de répondre à l’urgence. Donner aux appareils bureaucratiques modernes la possibilité d’exercer le pouvoir au nom de la survie de l’espèce, n’est-ce pas ôter une nouvelle fois toute limite à l’arbitraire ?
« L’État dont l’homme a voulu faire son ciel s’est toujours transformé en enfer[5]. » À trop vouloir jouer le jeu des puissances, on perd le pouvoir de changer les règles. À notre avis, l’échelle de l’État-nation n’est pas la bonne – trop petite pour transformer une économie globalisée, et trop grande pour lui échapper. Qu’on s’y attaque par la force ou par les urnes, la première mâchoire de notre tenaille est solide. La réelle capacité d’agir se trouve plutôt du côté des mouvements populaires. Comment les faire grandir ?
Dépasser l’hypothèse territoriale : réforme ou révolution ?
Ces dix dernières années, la ZAD est devenue une icône, pourchassée par le ministère de l’Intérieur, chérie par ses adeptes, objet de conflits internes et de cellules d’investigation spéciales. Au-delà de l’icône, les luttes territoriales forment une véritable hypothèse politique qui a renouvelé les imaginaires politiques et obtenu des victoires, parce qu’elle venait répondre à certaines impasses de la politique post-soviétique. Ces luttes diffuses se sont appuyées sur le mouvement altermondialiste, sur une insurrection régionale – zapatiste – et sur les contre-pouvoirs autonomes qu’elles ont constitués – chambre d’agriculture indépendante du Pays basque, syndicat de la montagne limousine, comités de quartier anti-expulsion à Barcelone. Dans une certaine mesure, cette hypothèse a permis d’échapper à l’alternative rouillée entre reforme et révolution, en déplaçant la focale de l’État vers des territoires localisés où attachements et pressions économiques ne jouent pas de la même manière.
Au lieu de chercher à transformer, par le haut ou par le bas, une structure sociale verrouillée de toute part, il devenait possible de la trouer en certains points précis, capables de rayonner très largement.
Mais, pour le dire rapidement, soustraire certains espaces aux pouvoirs économiques et politiques institués ne nous semble pas une possibilité suffisamment extensible pour former une stratégie. Imaginer stopper les ravages de l’accumulation en multipliant les ZAD n’est probablement pas beaucoup plus sérieux que de penser arrêter le réchauffement climatique en accumulant les petits gestes. Cette fois-ci, c’est la mâchoire n°2 de notre tenaille qui referme son étreinte.
À moins, peut-être, de relier les points, et d’en attaquer d’autres. Notre tentative consiste, d’une part, à relier entre eux les territoires en lutte et les différentes formes de contre-pouvoirs de manière à former un réseau de résistance, d’autre part, à concentrer nos forces offensives sur certains axes précis, pariant que l’ordre industriel sera plus déséquilibré en faisant plier une filière qu’en multipliant des points de tension dispersés. Si nous nous inscrivons plutôt dans la tradition autonome, une partie au moins de cette culture souffre d’un travers gauchiste qui consiste à préparer la révolution en refusant de s’organiser au-delà d’un cercle immédiat de relations affectives. Une telle tentative signifie-t-elle un retour à la macro-politique tant décriée ? De fait, nous voilà de nouveau précipités sur l’échelle nationale : soutien aux demandes de moratoire sur la construction de mégabassines ou de routes, réflexions sur une réforme du foncier, voire de la politique agricole, les trois années de luttes des Soulèvements de la terre nous ont amené.es à des espaces politico-médiatiques dont les luttes territoriales se tiennent habituellement éloignées.
Peut-être la tenaille se refermera-t-elle sur nous. Peut-être serons-nous écrasé.es, par absorption dans le champ politique traditionnel ou par exclusion dans ses marges. En attendant, nous comptons bien continuer à lui maintenir de force les mâchoires ouvertes.
Les Soulèvements de la Terre
-
On peut citer, par exemple, Pierre Charbonnier parmi les penseurs français représentatifs de ce courant. ↑
-
Dont se revendique Andreas Malm dans La chauve-souris et le capital. Contrairement au récit forgé par la Sous-direction anti-terroriste, et avec tout le respect dû à un penseur qui s’efforce de regarder la situation historique en face, nous ne souscrivons pas aux propositions politiques de M. Malm. ↑
-
Ce terrifiant monstre marin venu du fond des âges mythologiques désigne l’Etat dans la philosophie politique moderne. Qu’il faille chevaucher un tel monstre pour organiser la vie commune, voilà l’imaginaire avec lequel nous voulons rompre. ↑
-
En France, Frédéric Lordon est sans doute un de ceux qui participe le plus à la force de l’imaginaire léniniste, qu’il verdit parfois. ↑
-
Holderlin, Hypérion, cité par François d’Eaubonne, Écologie/Féminisme, révolution ou mutation ? Le Passager clandestin, 2023. ↑





