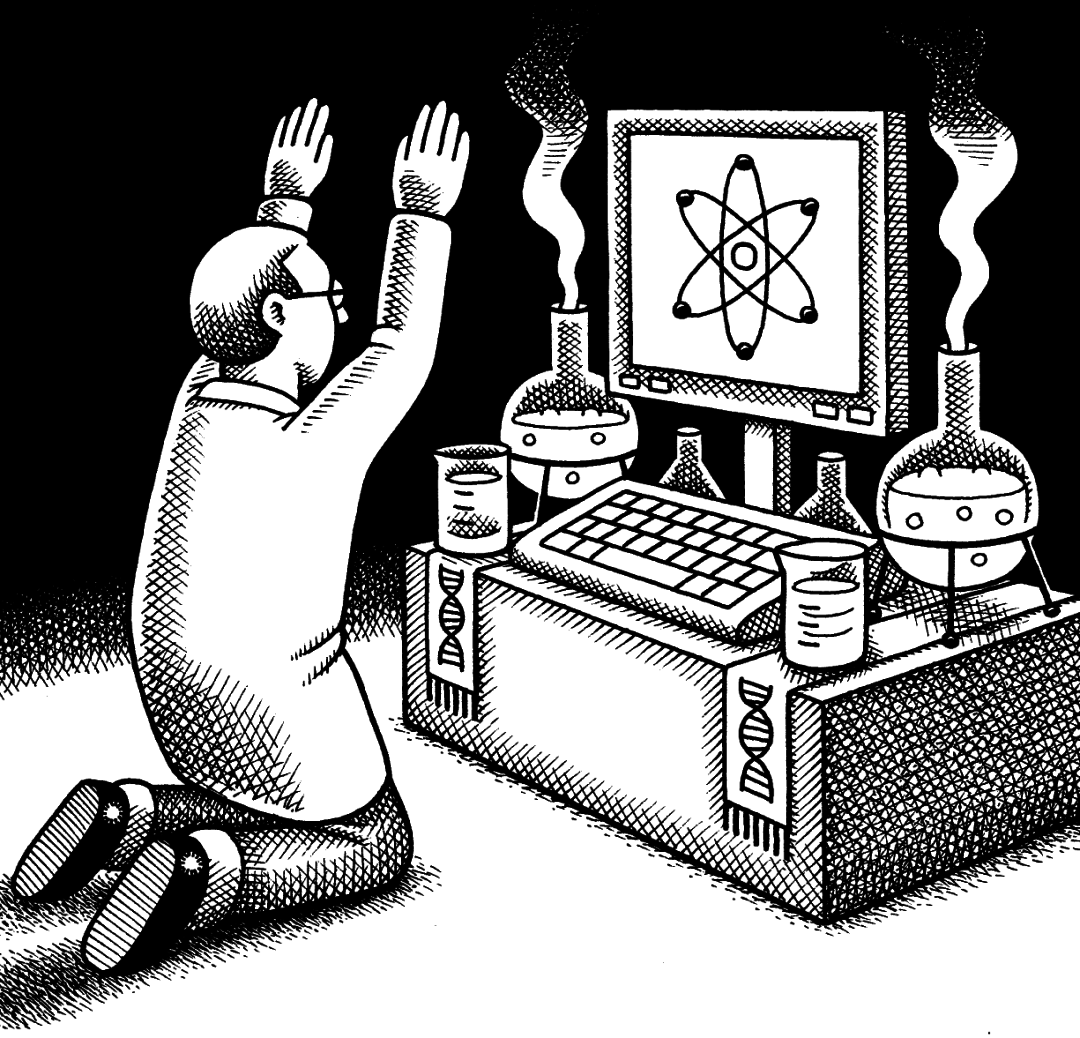L’urbanisation est à l’origine de la séparation entre nature et culture
« L’attitude des citadins à l’égard de l’environnement naturel témoigne d’un changement frappant par rapport à celle des chasseurs-cueilleurs, des premiers agriculteurs et des bergers. »
– J. Donald Hughes
Afin de mettre davantage en lumière le lien entre urbanisation, progrès technologique et dévastation écologique, j’ai traduit plusieurs extraits du livre An Environmental History of the World (2001) écrit par l’historien de l’environnement J. Donald Hughes. Je m’étais déjà basé sur un autre de ses excellents ouvrages, Environmental Problems of the Greeks and Romans (2014), pour montrer que les grandes civilisations ont toujours été une nuisance pour l’humanité et la nature.
Hughes explique dans ses écrits que, si les peuples pré-urbains ont parfois pu avoir un impact négatif sur leur environnement et les autres espèces, ce n’est qu’avec le développement des villes – et avec l’innovation technologique perpétuelle indispensable à leur existence – que les dégâts sur la nature ont commencé à être systématiques, massifs et permanents. L’intérêt majeur de l’histoire environnementale est de nous permettre de gagner du temps en mettant le doigt sur les causes matérielles profondes de la catastrophe écologique. Elle nous permet également d’écarter les analyses complètement hors sujet de cette crise et les solutions totalement aberrantes proposées à gauche comme à droite (mais surtout à gauche). Par exemple l’anthropologue Philippe Descola, un type adulé à gauche pour sa déconstruction de la notion de nature et son soutien au mouvement transhumaniste :
« La nature est un dispositif métaphysique, que l’Occident et les Européens ont inventé pour mettre en avant la distanciation des humains vis-à-vis du monde, un monde qui devenait alors un système de ressources, un domaine à explorer dont on essaye de comprendre les lois. »
Comme souvent, Descola raconte n’importe quoi. Hughes montre au contraire dans son œuvre que cette distanciation entre cuture et nature est apparue hors de l’Europe, notamment en Mésopotamie, au moment de la révolution urbaine il y a plusieurs millénaires. Voir par exemple ce morceau choisi tiré de Environmental Problems of the Greeks and Romans (2014) :
« L’attitude des citadins à l’égard de l’environnement naturel témoigne d’un changement frappant par rapport à celle des chasseurs-cueilleurs, des premiers agriculteurs et des bergers. C’est comme si les murs des villes et le tracé rectiligne des canaux avaient divisé les citadins de la nature sauvage et substitué une attitude de confrontation au sentiment de coopération qui prévalait auparavant. Cette attitude se retrouve dans la littérature du Proche-Orient, depuis les débuts de l’époque sumérienne jusqu’aux écrits akkadiens et assyriens, qui utilisent souvent l’image de la bataille pour décrire la nouvelle relation avec la nature. Dans les mythes de la création, la nature était représentée comme un monstre féminin du chaos qui était affronté et vaincu par un dieu-héros. Ce n’est que grâce aux conquêtes des dieux et au travail constant de leurs disciples humains que l’état chaotique naturel de l’univers a pu être dompté et que l’ordre a pu être établi. Le plan de la ville, avec ses rues droites et ses murs solides, et le tracé régulier des canaux dans la campagne, étaient considérés comme des imitations terrestres de l’ordre céleste que les dieux avaient établi. Les Mésopotamiens admiraient l’ordre des étoiles et des planètes ; ils les identifiaient à leurs dieux et ont développé l’astronomie et les mathématiques à un niveau sophistiqué.
L’épopée de Gilgamesh, peut-être l’un des plus anciens poèmes existants, révèle le sens qu’avaient donné les urbains de Mésopotamie à la distinction entre le sauvage et l’apprivoisé, entre la civilisation et la nature sauvage. Ce poème témoigne d’une attitude nouvelle et jusqu’alors inconnue d’hostilité à l’égard de la nature indomptée. Enkidu, l’homme poilu représentant la nature sauvage, apparaît d’abord dans le poème comme un ami et un protecteur des bêtes. Mais il représente une nuisance et même une menace pour les citadins, car il libère les animaux des pièges des chasseurs et les met en garde contre les embuscades. Lorsqu’il est apprivoisé, les anciens amis animaux d’Enkidu commencent à le craindre et s’enfuient. En entrant dans la ville d’Uruk, Enkidu rencontre le roi Gilgamesh. Il se bat d’abord avec lui, puis ils deviennent de proches amis. Ensemble, ils partent à la recherche de bois de cèdre dans les montagnes lointaines. Les tablettes mésopotamiennes décrivent le voyage de Gilgamesh, armé de sa puissante hache, et de son compagnon Enkidu jusqu’aux montagnes où ils combattent et tuent Humbaba, le dieu-animal gardien de la forêt de cèdres. Une fois le combat terminé, ils se mettent à couper les arbres de la forêt. Cette histoire est un mythe, mais elle reflète de nombreuses vérités historiques. La forêt mentionnée est probablement celle des cèdres du Liban (l’épopée la situe près de l’Euphrate), une source de bois pour la plaine mésopotamienne pauvre en arbres et soumise à une déforestation ancienne. La forêt était un bosquet sacré protégé par le géant sauvage Humbaba. Sa défaite et sa mort aux mains des deux héros symbolisaient l’assujettissement de la nature sauvage par la ville. Gilgamesh a rapidement coupé les cèdres et les a emportés à Uruk pour s’en servir dans la construction de son palais. Pour les Mésopotamiens, l’humanité devait travailler à domestiquer les espèces sauvages. C’est ce qu’ils ont fait avec des animaux indigènes tels que l’onagre [âne sauvage d’Asie, NdT] et le buffle d’eau qui venaient s’ajouter aux vaches, aux porcs, aux moutons et aux chèvres déjà apprivoisés par leurs ancêtres. Les animaux qui ne pouvaient pas être domestiqués étaient chassés sans pitié ; Gilgamesh aurait tué des lions simplement parce qu’il les voyait ‘‘se glorifier de la vie’’. »
Chose intéressante, Hughes considère que c’est la révolution urbaine et non la révolution agricole qui a été le « péché originel » de l’humanité :
« L’agriculture a permis une augmentation et une concentration des populations humaines ; les villages agricoles étaient généralement plus grands que les campements de chasseurs. Mais les conditions de vie des individus ne s’amélioraient généralement pas. Des études systématiques des ossements provenant de sépultures montrent que parmi les agriculteurs néolithiques, les hommes comme les femmes étaient moins grands que les chasseurs paléolithiques, avaient des dents et des os moins sains et vivaient moins longtemps. Étant plus nombreux, ils étaient plus exposés aux maladies transmissibles. Sans nécessairement le choisir, les agriculteurs avaient sacrifié une partie de leur santé, de leur intégrité physique et de leur espérance de vie au profit du nombre et d’une plus grande sécurité du groupe. Néanmoins, ils ont eu relativement peu d’impacts négatifs sur l’environnement. Ce n’est pas l’agriculture en soi qui a détruit la terre, mais certaines pratiques plus intensives qui allaient encore apparaître, telles que le labour et l’irrigation, combinées à la pression démographique qui rendait nécessaire l’exploitation agricole continue des terres. Certains spécialistes des relations entre l’homme et l’environnement ont suggéré que ‘‘la révolution agricole pourrait s’avérer être la plus grande erreur jamais commise dans la biosphère, une erreur non seulement pour Homo sapiens, mais aussi pour l’intégrité de tous les écosystèmes’’. En d’autres termes, ils considèrent qu’il s’agit du ‘‘péché originel’’ environnemental. Cette métaphore discutable serait peut-être plus appropriée si elle était appliquée à la révolution urbaine, le changement majeur qui a suivi l’apparition de l’agriculture dans le mode de vie humain, changement qui est abordé dans le chapitre suivant. »
Il illustre cela plus loin dans le livre en donnant l’exemple de l’agriculture traditionnelle des indiens Hopi.
Ci-dessous, un autre long extrait de l’ouvrage An Environmental History of the World (2001) qui décrit plus longuement comment les humains des premiers centres urbains ont peu à peu perçu la nature comme une chose étrangère, incontrôlable et menaçante.
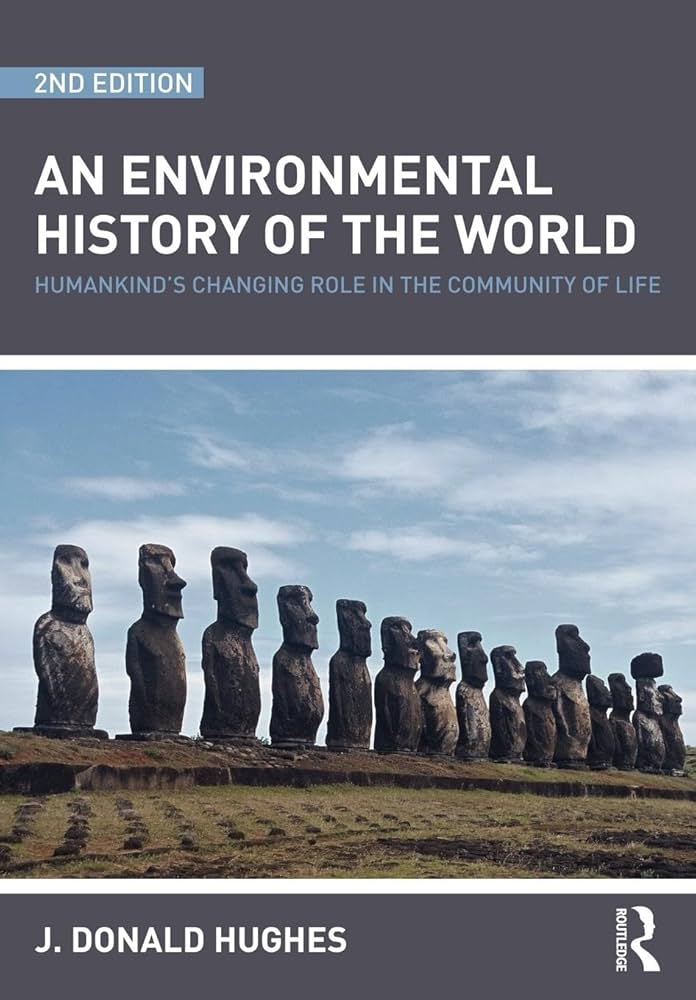
Le grand divorce entre culture et nature
Les villes ne sont pas séparées du monde naturel dont elles dépendent. Dans une ville du nord de l’Inde, des hommes et des femmes construisent un nouvel immeuble en grande partie à la main. Ils transportent sur leur tête des tuiles dans des seaux en bois, des tuiles faites d’argile cuite au feu de bois et de charbon de bois (du bois partiellement oxydé) provenant des forêts en voie de disparition sur les collines loin au nord. L’échafaudage est fait de bambou provenant des mêmes forêts, attaché avec des cordes de chanvre provenant des champs que l’on aperçoit au loin, dans la brume, depuis le sommet du bâtiment. Comme toutes les villes, celle-ci utilise des ressources importées depuis des terres proches ou lointaines.
À Shanghai, j’ai visité un marché où une variété étonnante d’étals bordaient la ruelle. On pouvait y trouver tous les produits de base pour la cuisine : des légumes et des fruits provenant des jardins situés juste à l’extérieur de la ville, des canards vivants provenant d’un lac voisin, des lotus, des châtaignes d’eau et des escargots que les paysans venaient vendre. Pour certains cette scène montre une série de transactions économiques, mais on peut également la voir autrement : ce sont des êtres humains qui manipulent et utilisent d’autres espèces animales et végétales.
Une randonnée facile depuis le centre d’Ávila, en Espagne, m’a conduit le long des rues bondées d’une capitale provinciale florissante. J’ai franchi une porte pour aller de l’autre côté des murs massifs de la cité. J’ai traversé les champs de blé, les vignobles et les oliveraies jusqu’à un point de vue où, en regardant derrière moi vers la ville, j’ai pu apercevoir les hauteurs de la Sierra couvertes de pins. Sur cette courte distance, j’ai pu voir des exemples illustrant les nombreuses et diverses façons dont la terre est utilisée pour répondre aux préférences et aux besoins d’une population urbaine.
Chacune de ces scènes a quelque chose d’important en commun avec les premières villes qui ont vu le jour dans les vallées fluviales de Mésopotamie, du Nil et de l’Indus, ou sur les plaines loessiques[1] du nord de la Chine. L’État avec ses institutions religieuses et politiques, la spécialisation du travail, la stratification de la société en classes et le développement d’arts tels que l’architecture monumentale, l’écriture et la mesure de l’espace et du temps, sont apparus pour la première fois et se sont principalement développés dans ces grands centres humains densément peuplés. La ville est une relation humaine structurée avec l’environnement naturel. Bien qu’il s’agisse d’une création artificielle de la culture humaine, elle peut également être considérée comme un écosystème lié à d’autres écosystèmes. Chaque activité humaine qui s’y déroule nécessite certaines ressources provenant de la nature environnante. La ville n’est pas un phénomène tronqué, mais s’inscrit dans un contexte naturel composé des nombreux cycles de substances organiques et inorganiques qui l’influencent constamment. Les villes font partie des écosystèmes au sein deslesquels elles existent, même si elles y apportent des changements importants et réorganisent la nature à leur avantage. Trop souvent, les villes sont étudiées uniquement comme une série de relations sociales humaines et d’arrangements économiques, et leurs liens intimes, constants et nécessaires avec les processus naturels de la Terre sont oubliés.
Une agriculture plus productive était la condition nécessaire à la naissance des villes, car celles-ci étaient plus grandes, plus densément peuplées et organisées de manière plus complexe que les villages qui les avaient précédées. Elles avaient besoin d’une base économique agraire capable de produire un excédent alimentaire. Cela a été réalisé en partie en étendant les terres cultivées au détriment des forêts, des zones humides et des terres arides. Mais pour nourrir un grand nombre d’hommes et de femmes engagés dans des activités non alimentaires, tels que les dirigeants, les prêtres, les commandants militaires et les scribes, il était nécessaire de mettre en place un système dans lequel le travail d’une famille d’agriculteurs pouvait fournir de la nourriture à d’autres personnes en dehors du cercle familial paysan. Cela a souvent été réalisé grâce à une gestion à grande échelle de l’eau. Ces importants systèmes d’irrigation servaient à contrôler les crues ou à alimenter les champs en eau par des canaux.
L’alimentation de base des citadins était composée de céréales telles que le blé, l’orge et le millet. Le riz était cultivé en Chine dès la dynastie Shang (vers 1750-1100 avant J.-C.) et était probablement présent dans la vallée de l’Indus à peu près à la même époque. La charrue, une innovation technologique, a contribué à créer un excédent agricole et a ainsi rendu possible l’apparition des villes. La sélection des semences, les techniques de fertilisation et la rotation des cultures ont également contribué à cette évolution.
Les effets du contrôle des crues et de l’irrigation sur l’environnement faisaient partie des conséquences de l’urbanisation. Les rivières transportent du sable, du limon et des matières organiques en suspension, qui se déposent lorsque le courant ralentit. Lorsque les rivières étaient contenues entre des digues pour prévenir les inondations, comme en Mésopotamie et dans le nord de la Chine, cela provoquait une élévation du lit de la rivière au-dessus des terres environnantes et aggravait les inondations lorsque les digues finissaient par céder. L’envasement se produit également dans les canaux et, à moins que les populations n’assument la lourde tâche d’évacuer les sédiments vers des berges adjacentes, il réduit la durée de vie utile de ces ouvrages. À terme, l’envasement peut les obstruer malgré ces efforts. Un autre effet était la salinisation, c’est-à-dire l’augmentation progressive de la teneur en sel des sols gorgés d’eau à la suite de l’évaporation. L’eau qui coule dissout le sel, et ce phénomène s’accentue lorsque la déforestation expose les roches salines aux précipitations. Lorsque l’eau se répand sur les champs et s’évapore, le sel s’accumule. Des concentrations élevées de sel entravent la germination et empêchent l’absorption d’eau et de nutriments par les plantes, ou empêchent leur croissance. La salinisation peut être grave partout où l’irrigation est pratiquée dans des climats secs sur des sols mal drainés, ce qui était le cas dans une grande partie de la Mésopotamie et de la vallée de l’Indus.
L’essor des villes a créé une demande en matériaux et en combustibles. L’architecture est devenue vaste, complexe et massive. Les besoins en matériaux de construction étaient immenses, compte tenu des résidences et des lieux d’affaires, des temples, des palais et des tombes, ainsi que des murs et des citadelles. La plupart des matériaux de construction provenaient de la terre, sous forme d’argile séchée au soleil ou cuite en briques, et de pierre. Les carrières de pierre ont marqué de nombreuses collines. Le combustible nécessaire aux fours à briques exigeait d’énormes quantités de bois et de charbon de bois qui provenaient des forêts. Les villes de la vallée de l’Indus étaient par exemple construites en briques cuites. Le bois était également d’une importance capitale dans la construction, car il servait à soutenir les plafonds et les toits, ainsi qu’à ériger des échafaudages pendant la construction, ce qui accentuait la pression sur les forêts.
Une métallurgie améliorée a permis de fabriquer des outils, des armes et des ornements en cuivre, puis en bronze. Les villes étaient souvent des centres métallurgiques ou donnaient naissance à de tels centres dans leurs environs, et la demande en combustible menaçait les forêts. Le minerai devait être extrait du sol, laissant derrière lui des fosses et des tunnels. Il devait ensuite être porté à une température élevée pour être fondu (2012 °F ou 1100 °C pour le cuivre), ce qui nécessitait la combustion de bois ou de charbon de bois. Il fallait environ 15 à 25 tonnes de charbon de bois pour produire une tonne de cuivre. Cette seule utilisation dans un grand centre de production aurait entraîné la destruction de centaines de milliers d’hectares d’arbres. Les composés du cuivre sont toxiques, ce qui exposait les travailleurs à des risques, et la pollution causée par les déchets de la production était dangereuse pour les humains et les autres organismes.
La population s’est répartie entre plusieurs nouveaux métiers, dont certains étaient nouveaux et propres à la ville. En conséquence, de nombreux citoyens des centres urbains appartenaient à des groupes dont les emplois les isolaient de la terre et ne travaillaient plus en contact étroit avec les animaux et les plantes. Ils passaient leur temps à l’intérieur ou sur les marchés, à fabriquer ou à vendre des produits, ou à travailler dans l’administration, le droit et la religion. Leur nourriture était obtenue par le commerce, et non directement à la source. Les personnes les plus urbanisées comprenaient les dirigeants et les décideurs politiques.
Les guerriers tentaient de défendre les terres agricoles et autres ressources de la ville, et s’efforçaient de s’emparer de celles des villes voisines. Avant l’adoption des chevaux et des chars, le succès dépendait du nombre de fantassins présents sur le champ de bataille. Les commandants exigeaient le service de presque tous les hommes valides et faisaient du statut de guerrier une condition requise pour obtenir la citoyenneté, ce qui empêchait les femmes de participer officiellement à la vie politique. Les actes de guerre destructeurs pour l’environnement étaient souvent commis délibérément afin de priver les villes rivales de leurs moyens de subsistance et de résistance. Les armées allumaient des incendies, piétinaient les récoltes, abattaient les arbres et perturbaient l’approvisionnement en eau.
Les marchands formaient un groupe professionnel important dans les premières villes, et le marché s’est développé, généralement sous la forme d’une place ouverte près du centre, entourée d’une passerelle couverte où des étals ou des boutiques pouvaient être installés. On y vendait les produits issus des fermes locales, de l’artisanat et des vêtements. En outre, des services tels que la coupe des cheveux et le soin des dents étaient disponibles, ainsi que des plats préparés et des boissons alcoolisées. Dès le début, le marché a eu des effets notables sur l’environnement, facilitant l’échange de ressources et augmentant la demande pour celles-ci.
La croissance démographique et la densification de la population ont entraîné des problèmes de pollution, d’élimination des déchets et de propagation des maladies, affectant la santé, la stature et la longévité des habitants. L’eau potable était puisée dans des puits, des rivières et des canaux susceptibles d’être contaminés. Des documents mésopotamiens mentionnent le danger de mort lié à la consommation d’eau insalubre. À la pollution causée par les eaux usées et les déchets s’ajoutaient les déchets issus des activités industrielles telles que la métallurgie, le tannage du cuir et la poterie. Ces déchets s’accumulaient jusqu’à ce que la pluie les emporte dans les rivières et les nappes phréatiques. Quelques-unes des premières villes ont mis en place des systèmes d’évacuation ou construit des égouts et des latrines, comme ceux que l’on trouve dans les ruines de Cnossos en Crète. Les déchets, ainsi que la concentration de corps humains et de denrées alimentaires stockées, attiraient des organismes opportunistes.
La santé humaine a décliné à tous les niveaux. Les villageois néolithiques étaient en moins bonne santé que les chasseurs et les éleveurs, mais les citadins ont connu un déclin encore plus marqué ; des études sur leurs restes squelettiques montrent qu’ils étaient plus petits, vivaient moins longtemps, souffraient davantage de problèmes dentaires et osseux et étaient sujets aux maladies transmissibles. À ces dangers s’ajoutaient les guerres, l’esclavage et les sacrifices humains. Un compromis inconscient avait été fait, qui sacrifiait la qualité de vie au profit de la quantité et de la sécurité de la communauté. Pour les individus, la vie urbaine était rarement une amélioration par rapport aux sociétés antérieures.
Tout aussi importante que la transformation de l’environnement dans lequel se trouvait la ville était la manière dont les besoins urbains affectaient les zones environnantes à plus grande distance à mesure que la ville s’agrandissait. Les villes pouvaient exploiter des ressources éloignées, directement et indirectement, devenant ainsi dépendantes de routes commerciales vulnérables aux groupes étrangers hostiles ou aux catastrophes naturelles.
L’effet le plus néfaste des villes sur l’environnement était la déforestation résultant de la demande en matériaux de construction et en combustibles. Elle a commencé près des centres urbains et s’est propagée vers l’extérieur le long des voies de transport telles que les fleuves, les côtes et les routes. Les produits forestiers sont lourds et volumineux, et ont été exploités autant que possible par les voies les plus courtes et les plus faciles. Cependant, de nombreuses villes ont dû s’approvisionner en important des produits sur de longues distances. Les villes de la vallée de l’Indus, par exemple, importaient du bois de cèdre de l’Himalaya. Les forêts de cèdres du Liban fournissaient du bois aux Sumériens et aux Égyptiens, qui devaient le transporter sur de longues distances. Plus tard, le roi Hiram de Tyr a donné du bois de cèdre et de cyprès au roi Salomon pour construire le temple de Jérusalem ; il a été transporté sous forme de radeaux maritimes.
Dans l’Antiquité, la guerre était synonyme de destruction, et l’environnement naturel n’était pas épargné. Les récoltes étaient détruites lorsque les armées marchaient dessus ou livraient bataille dans les champs, même si le sang et les cadavres pouvaient brièvement fertiliser le sol. Des dommages plus durables étaient causés par l’abattage des vergers, une pratique interdite par la Bible hébraïque. Les armées incendiaient également les forêts, détournaient les cours d’eau et polluaient délibérément les sources d’eau.
Bon nombre des régions où les premières villes ont vu le jour sont aujourd’hui arides et peu végétalisées. Il est frappant de voir les vestiges d’une grande ville comme Ur, avec son imposante ziggourat (une structure en forme de pyramide à degrés surmontée d’un temple), ou la citadelle de Mohenjo-Daro, entourées de paysages desséchés et largement désertés. La désertification est intensifiée par la salinisation, et ces deux processus se sont produits à proximité des villes. Un autre facteur mis en évidence par les études hydrologiques est la modification des cours d’eau. Les canaux du fleuve Jaune, du Tigre et de l’Euphrate, ainsi que de l’Indus et de ses affluents, se sont déplacés sur des distances importantes. Si bon nombre de ces déplacements, souvent désastreux, se sont produits spontanément, d’autres ont été provoqués par la construction de canaux et d’autres ouvrages de contrôle des eaux, ainsi que par la déforestation et les inondations et assèchements qui en ont résulté. Ainsi, les premières villes ont contribué à créer les déserts qui les ont ensuite submergées. Il semble que le progrès n’a rien d’une loi inscrite dans le marbre.
La ville ne peut être comprise correctement que si elle est considérée comme un écosystème, c’est-à-dire comme une série de relations écologiques. Elle n’existe pas de manière isolée, mais interagit avec d’autres écosystèmes et fonctionne comme partie intégrante d’un écosystème plus vaste. Une étude de la ville doit donc considérer les facteurs sociaux humains comme opérant au sein d’une série complexe de processus écologiques qui les influencent et les affectent. Les citadins, comme leurs ancêtres néolithiques, dépendaient d’un système naturel pour leur survie. Mais ce fait était moins immédiat pour eux. Les réactions des systèmes naturels étaient moins instantanées. Il pouvait donc leur sembler que la culture et la nature étaient deux domaines distincts, et que la culture, représentant l’ordre et la sécurité, devait dominer la nature chaotique.
Ce point de vue était erroné. La ville de l’âge du bronze afro-asiatique (environ 3000-1000 avant J.-C.) faisait tout autant partie de l’écosystème global que le village néolithique ou le campement des chasseurs paléolithiques. Elle était toutefois plus peuplée et plus complexe. Ses décisions avaient un impact plus important sur l’environnement et devaient s’appuyer sur une meilleure connaissance du fonctionnement des écosystèmes environnants. Cette connaissance n’était pas toujours disponible. Les erreurs commises dans les arrangements économiques urbains avaient des conséquences plus importantes qu’auparavant et pouvaient signifier qu’une ville imposait à l’environnement des exigences qui n’étaient pas soutenables sur le plan écologique. Cela s’est effectivement produit à de nombreuses reprises. Les villes ont rétréci, ou leurs sites ont été complètement abandonnés. Mais avant que cela ne se produise, ou pendant que cela se produisait, elles ont épuisé leur environnement, et ce sur un vaste territoire, incluant parfois des endroits éloignés d’où elles tiraient leurs ressources. La culture a agi comme si elle était séparée de la nature, à ses propres risques et périls.
J. Donald Hughes
Loess : Le lœss (ou loess) est un dépôt sédimentaire détritique meuble formé par l’accumulation de limons issus de l’érosion éolienne, dans les régions désertiques et périglaciaires (ceintures péridésertique et périglaciaire). (Wikipédia) ↑