
Pourquoi et comment l’État a éradiqué les paysans
« L’ethnocide des paysans, il s’agit bien de la destruction d’une culture, d’un monde, ou plutôt de mondes car il existait des sociétés paysannes/rurales diverses, contrairement au modèle uniformisateur de la société urbaine, industrielle puis de services, dont la mondialisation néolibérale accélère l’installation aux quatre coins de la planète. Partout, sous l’effet de la disparition des paysans et du déploiement du capitalisme productiviste, la diversité recule, les paysages s’uniformisent, les formes de vie sociale se ressemblent, la pluralité et l’autonomie des cultures s’effacent, au profit d’un “Grand Tout” qui colonise et marchandise la moindre parcelle de terre, le moindre compartiment de nos vies.
À propos de cet ethnocide, il faut aussi insister sur la façon dont on a, durant des siècles et très majoritairement, considéré les paysans et leurs sociétés comme des Indiens, des sauvages de l’intérieur, qu’il fallait réduire, convertir de gré ou de force à la modernité. Ils représentaient, comme les Indiens d’Amérique ou tout autre peuple autochtone, cet “Autre” encore autonome qui devait être éliminé ou acculturé, afin que se développent partout l’État moderne, le capitalisme, le productivisme et les nouvelles dépendances individuelles qui leur sont liées[1]. »
– Pierre Bitoun
Ce n’est un secret pour personne, le monde agricole est en crise depuis des décennies. Agriculteurs et éleveurs se suicident en masse[2], et chaque semaine 200 fermes disparaissent en France[3]. Afin de comprendre pourquoi et comment la paysannerie a été délibérément démantelée par l’État, j’ai reproduit deux extraits du livre Le sacrifice des paysans. Une catastrophe sociale et anthropologique (2016) publié par les sociologues Yves Dupont et Pierre Bitoun. Le premier passage s’attarde sur le processus de modernisation de l’agriculture mis en œuvre par les États après la Seconde Guerre mondiale, le second est la conclusion du livre. Les deux auteurs y livrent les raisons qui ont poussé les technocrates modernisateurs à évincer le monde paysan.
À lire l’anthropologue James C. Scott, il semblerait que cette guerre menée aux paysans soit en réalité plurimillénaire. Le développement d’un État et sa stabilité dans le temps sont depuis les premières civilisations conditionnés par la soumission militaire, le contrôle politique et la taxation de populations paysannes[4]. La mise en place d’infrastructures de transport et de communication à longue distance rend ce processus plus efficace, transformant de simples cités-États en royaumes puis en empires. Sous l’Empire romain, les riches propriétaires terriens, pour la plupart urbains, employaient des paysans-esclaves dans des champs cultivés en monoculture. De même, le régime féodal, qui apparaît après l’an 1000 en Europe, a réduit en esclavage une paysannerie majoritairement libre, lui a imposé la monoculture céréalière ainsi que des techniques de transformation (notamment l’obligation payante d’utiliser le moulin seigneurial plutôt que les petites meules familiales[5]). Cette guerre se poursuit aujourd’hui. Le progrès technologique ayant rendu obsolète la main-d’œuvre dans les champs de céréales, les paysans sont désormais inutiles. Ils représentent un frein au développement des capacités productives, donc de la puissance économique, et doivent par conséquent se reconvertir dans d’autres secteurs d’activité.
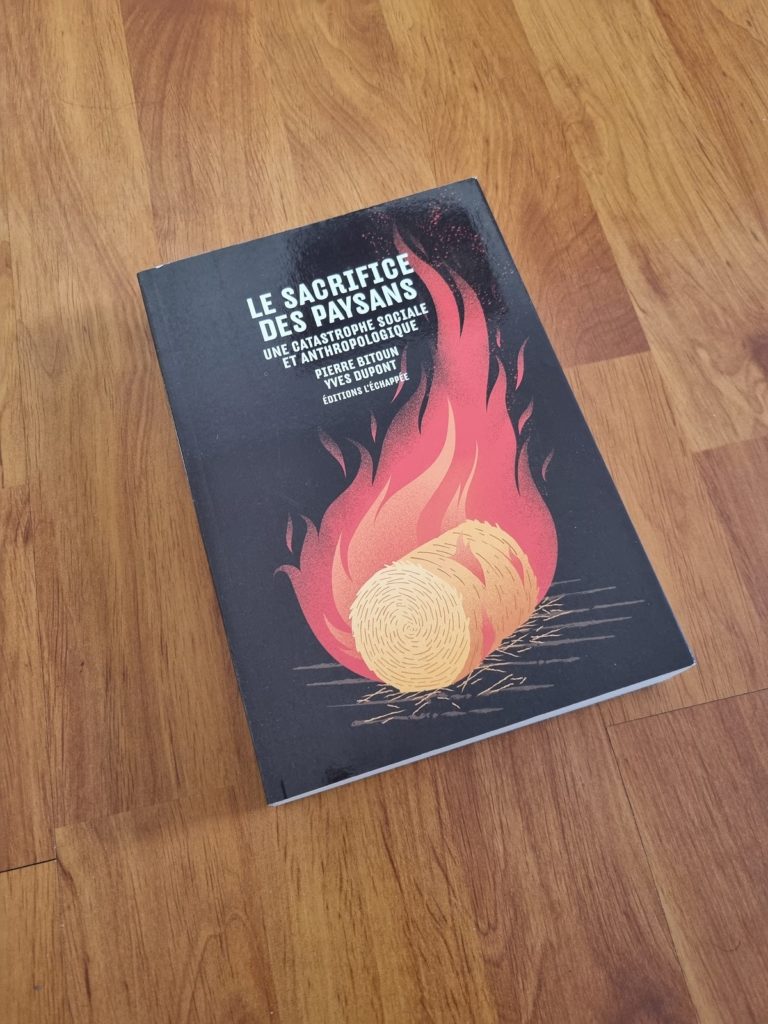
Le microbe modernisation (par Pierre Bitoun et Yves Dupont)
Avec l’avènement, puis l’expansion de la société industrielle et du marché généralisé depuis le milieu du XIXe siècle, les sociétés paysannes furent, de manière plus ou moins rapide dans les pays développés, et plus brutalement dans d’autres, profondément remodelées. D’une façon générale, une majorité d’individus, y compris dans leurs rangs, considéra en effet que les paysans, dont le qualificatif fut progressivement restreint à ceux qui travaillaient la terre, devaient se transformer en agriculteurs puis en chefs d’entreprise. Et que ceux qui n’y parviendraient pas devraient aller travailler en usine ou dans les administrations, en ville ou à la campagne. Signe de ce qu’une profonde mutation anthropologique s’amorçait là, la caractérisation des populations par leurs mœurs, leurs valeurs et leur culture, dut céder le pas au classement des individus en fonction de leur métier, de leur mobilité ou de leur position économique, bref de leur intégration à l’intérieur d’un macrosystème unificateur. S’institua alors un procès politique et économique d’atomisation d’êtres auparavant inscrits dans un ensemble de relations sociales plus ou moins particularisées. Mais au fond, c’est l’ensemble des traits culturels qui caractérisaient les paysans qui fit l’objet d’un travail systématique de disqualification, d’appréciations négatives moqueuses ou quelquefois violentes, portant sur les langues, dialectes et patois régionaux ou locaux, mais aussi les manières d’être et de faire : costumes, manières de table et modes d’alimentation, croyances et superstitions, etc. Ils durent par conséquent, délibérément ou non, s’intégrer dans une société de masse, et l’autonomie relative des collectivités locales disparut au profit d’un système politico-administratif qui étendit son emprise et son pouvoir sur l’ensemble du territoire national. Comme l’a bien remarqué Priscilla De Roo, « le redéploiement industriel et la conquête de la France rurale [sont allés] de pair avec la nécessité de moderniser les relais de pouvoir territoriaux ». En une trentaine d’années (1945-1975), la production agricole devint commandée par les exigences du marché, la plupart des groupes domestiques se transformèrent en entreprises familiales de petite production marchande, l’autoconsommation ne cessa de régresser et la consommation familiale ne subsista plus, dans l’ensemble, que comme un trait culturel particulariste. Ainsi, si l’on se réfère aux ouvrages qui ont traité de cette question, les paysans auraient, en France, pratiquement disparu dès la fin des années 1970. Et avec eux la signification que recouvrait le terme de paysan.
Comme nous l’avons déjà indiqué, la fascination qu’exerça sur la majorité des hommes politiques la puissance du modèle américain après la Seconde Guerre mondiale les convainquit de ce que l’agriculture devait impérativement se moderniser, puis s’industrialiser. Et l’économiste Michel Gervais put montrer à ce propos, dans le tome IV de l’Histoire de la France rurale, qu’une même conception à la fois étroite et volontariste du développement économique de l’agriculture avait prévalu dès la Libération. S’il faut souligner que le pays était complètement sinistré et que la production alimentaire était alors loin de pouvoir répondre aux besoins de la population, ce développement fut aussi envisagé comme devant s’appuyer sur la mise en œuvre d’outils économiques et de procédés techniques que beaucoup de politiques et de technocrates concevaient comme politiquement, socialement et écologiquement neutres. Ce fut, écrit Michel Gervais, la période du règne du « il faut ». Il fallait moderniser, équiper, rationaliser, augmenter les rendements et construire une agriculture extrêmement productive qui destinerait la totalité de sa production à la vente et donc au marché. Ce qui impliquait évidemment le démantèlement du système de polyculture-élevage et la spécialisation des exploitations dans une ou deux productions principales destinées à être commercialisées. Le reste suivrait presque mécaniquement, tout le socle de la « vieille » France rurale serait ébranlé et la modernisation finirait par l’emporter. Toute volonté de résistance à l’application de ces orientations et de ces techniques, toute manifestation de défiance ou de prudence à l’égard de la modernisation devinrent dès lors suspectes, et ceux qui s’obstinèrent malgré tout à maintenir des pratiques analysées comme relevant d’un désir d’autarcie paysanne ou d’une mentalité de « boutiquiers » pour les artisans et commerçants, furent considérés comme bornés et obscurantistes. Ce dont témoigna, par exemple, le mouvement de révolte que l’on qualifia de « poujadisme » et qui fut aussi violent que populaire. On put même, à l’instar de Daniel Faucher en 1948, traiter ces formes de résistance à l’innovation comme relevant d’une quasi-pathologie culturelle :
« Tous les vieux systèmes agricoles sont ébranlés dans leur contenu et leurs justifications accoutumées. La tradition prend conscience de son infériorité, elle sait qu’elle a perdu ou qu’elle perd ses chances de durée. La routine bat désormais en retraite. Tel usage agricole, telle technique, telle culture même sont rejetés dans le souvenir. On les voit, on les verra de plus en plus s’incorporer à ce folklore paysan qui est en partie le témoignage de disparitions de même sorte. Et dans le même temps, le monde paysan passe de l’irrationnel au rationnel. »
S’imposèrent alors aux paysans, pour décrire leur arriération supposée, les catégories du primitivisme héritées de la colonisation et leur attribuant une série de traits archaïques, de survivances, voire de manques ontologiques par rapport à l’homme moderne.
Des couples d’oppositions binaires dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils étaient d’une forte charge idéologique se mirent alors durablement en place. On opposa ainsi et sans aucun autre procès la tradition à la modernité, la rationalité à l’irrationalité, la routine à l’innovation, la lenteur à la vitesse, le rural à l’urbain, la communauté à la société, le sous-développement au développement, le conservatisme au progressisme, l’organicisme à la démocratie, l’enracinement au déracinement, en deux mots, les Ténèbres aux Lumières. Ainsi, pour Daniel Faucher, la routine paysanne pouvait être définie comme la résistance qu’opposent les travailleurs de la terre aux nouveautés qui leur sont offertes : « Dès que le système est clos, l’intelligence est close, tout y devient tradition, c’est-à-dire routine. » On ne pouvait être plus clair.
Du côté des experts, comme cela fut le cas pour l’agronome René Dumont avant qu’il ne change radicalement de position beaucoup plus tard, on était bien de cet avis. Après avoir rédigé un essai apologétique traitant du développement de l’agriculture américaine, il écrivit en 1946 dans un autre de ses ouvrages : « Les seules bases solides, durables, de la prospérité rurale, donc du relèvement du niveau de vie paysan, sont un large accroissement de la productivité unitaire des campagnes, par le matériel moderne ; une structure plus rationnelle de notre agriculture, puis une extension des débouchés par le relèvement du standing général, surtout alimentaire. » La Commission de modernisation de l’équipement rural du Commissariat général au Plan campait sur les mêmes positions lorsqu’elle annonçait, dans un style dont seuls certains détiennent le secret, qu’il était temps d’en finir avec la tradition. Il y a, pouvait-on lire dans son premier rapport en 1946, « un terrain psychologique à préparer par une propagande intelligente qui fera comprendre aux agriculteurs l’intérêt de la rationalisation de leurs techniques. Il faut établir l’état de réceptivité au microbe “modernisation”, que l’on nous passe cette métaphore biologique, en créant des foyers d’infection. » Le même discours était tenu en 1949 par les membres de la Commission du machinisme agricole du Conseil supérieur de l’agriculture :
« L’exploitation familiale n’attache pas une grande importance au capital investi mais cherche avant tout à rémunérer son travail. […] Or si on équipe cette catégorie d’exploitation et si, en particulier, on l’intègre fortement dans la vie économique générale par l’introduction du tracteur, l’exploitant familial va être amené à compter. Cette évolution ne va se faire immédiatement. Il faut prévoir que les organismes officiels et professionnels vont être contraints à compter en lieu et place de l’exploitant familial inexpérimenté. »
On baptisa ainsi développement l’ensemble de ces politiques de dépaysannisation qui constituaient le socle d’un processus de mondialisation en marche depuis longtemps et qui s’appliqua, selon des modalités plus ou moins brutales, à l’ensemble de la planète :
« […] à partir de 1949, plus de deux milliards d’habitants de la planète vont – le plus souvent à leur insu – être considérés officiellement, si l’on peut dire, tels qu’ils apparaissent dans le regard de l’autre, et être mis en demeure de rechercher ainsi leur occidentalisation en profondeur, au mépris de leurs propres valeurs ; ils ne seront plus Africains, Latino-Américains ou Asiatiques (pour ne pas dire Bambaras, Shona, Berbères, Quechuas, Aymaras, Balinais ou Mongols) mais simplement “sous-développés”. Et, comme le remarque justement Silvia Pérez-Vitoria, il s’agit toujours de sociétés paysannes. »
Comparé à ces fortes incitations émanant aussi bien des agronomes ou des économistes que de divers représentants de la puissance publique, le premier alinéa de l’article 1 des lois d’orientation de l’agriculture des 2 et 5 août 1960 semblait à peine plus empreint d’esprit modernisateur, en même temps qu’il révélait les contradictions dans lesquelles se trouvaient pris tous ceux qui hésitaient entre la thèse de l’inéluctable industrialisation de l’agriculture et le démenti que lui offrait encore à l’époque l’adaptation des exploitations familiales à la modernisation de l’agriculture par le biais d’une poursuite maîtrisée du mouvement d’intensification. Il faut, pouvait-on lire d’un côté dans cet alinéa, « promouvoir et favoriser une structure d’exploitation de type familial susceptible d’utiliser au mieux les méthodes modernes de production et permettre le plein emploi du travail et du capital d’exploitation ». Mais immédiatement après, il était écrit ceci :
« L’exploitation familiale est une entreprise qui permet d’une part d’occuper deux ou trois travailleurs à temps complet […] et qui permet moyennant une gestion rationnelle d’obtenir un revenu équitable par rapport à des groupes professionnels comparables. »
On pouvait ainsi constater que les exploitants familiaux, attachés au système de polyculture-élevage et à la maîtrise de leurs transactions, continuaient souvent, en 1960 et après, à ne pas séparer les activités et les comptes de la famille (du ménage) et de l’exploitation (de l’entreprise), du « Haushalt » et du « Betrieb » selon Max Weber, pour lequel la séparation de ces deux composantes constituait une condition essentielle d’émergence de l’économie moderne et de la comptabilité rationnelle. Enfin, il faut souligner que le revenu équitable par rapport à des groupes professionnels comparables était à l’époque plus ou moins implicitement évalué en référence aux salaires cumulés d’un couple d’ouvriers qualifiés qui, chacun le sait, n’ont que peu de rapports de commensurabilité avec le revenu de véritables entrepreneurs.
Les sept raisons du sacrifice des paysans (par Pierre Bitoun et Yves Dupont)
Que le paysan, et les sociétés paysannes défuntes des pays dit développés, deviennent objet de musée, n’a en soi rien d’étonnant. Non seulement on peut y lire l’une des manifestations de la passion commémorielle qui partout étreint les modernes, et davantage encore les postmodernes, non seulement il faut y voir un rituel d’enterrement, sépulcral autant que compensateur, d’une civilisation ancienne que l’on a sciemment détruite, mais surtout, cette muséification ne représente que l’un des éléments démontrant le caractère central du sacrifice des paysans dans la production de la modernité et son déploiement actuel ou à venir. Presque parvenus à la fin de ce livre, il nous a paru ainsi indispensable de rassembler, sous une forme aussi exhaustive et succincte que possible, les raisons de ce sacrifice. Elles sont – au moins – sept et elles renvoient toutes, de façon réelle ou symbolique, à l’archétype humain qu’est le paysan :
1. L’homme, ancêtre de l’humanité, symbole de sa préhistoire et des toutes premières formes de sociétés humaines, que le civilisé ne tardera pas à tenir pour sauvage, le progressiste pour archaïque, le productiviste forcené pour une entrave à la marchandisation généralisée. Autrement dit, « un brouillon d’humanité » qu’il faut sacrifier sur l’autel de l’Histoire du Développement.
2. L’homme en relation immédiate – ou supposée immédiate – avec la nature, l’animal, la matière ou les matières (terre, corps, chair, sang, excréments, etc.). En cela, il fait peur et incarne l’antithèse de la modernité hygiéniste, aseptisée, plus encline à l’apparente propreté des choses qu’au contact direct avec l’organique. En cela, il est le païen – du latin paganus, le « paysan » –, le polythéiste, contraire à la religion de l’Un, Dieu ou la Science. En cela, il est l’opposé, non de l’artefact humain, mais de l’artificialisation illimitée portée par le projet de maîtrise et de possession de la nature, le productivisme machinique, le laboratoire des technosciences. L’inverse, en résumé, du cyborg.
3. L’homme de l’autonomie précapitaliste, de l’oïkos grec et de la petite production marchande, de l’économie encastrée dans le tout social et subordonnée au fait de « faire communauté ou société », des moyens et des fins conçus ensemble. Par là, il est à nouveau une antithèse : de la généralisation de la valeur d’échange et de la monétarisation, de l’Homo oeconomicus et du capitalisme-productiviste mondialisé, de la production des moyens devenue la fin de l’existence humaine. Il est, en un mot, l’antiprométhéen.
4. L’homme de l’auto-organisation politique, corollaire logique de l’autonomie précapitaliste. Qu’on envisage la longue histoire de ses rébellions ou de ses constructions sociales communautaires, qu’on le regarde comme l’un des acteurs du « trésor perdu » des révolutions ou le porteur le plus résolu et désobéissant de la société prudente, solidaire et pluraliste, il dessine de toute façon un imaginaire contraire à celui de la domination de l’État moderne, du capitalisme, de la bureaucratie et de la démocratie représentative des citoyens. Il est, en cela, le dominé le plus rétif à l’hétéronomie politique, et c’est donc aussi à ce titre qu’il faut continuer sa liquidation ou son absorption en tant qu’agriculteur.
5. L’homme de la culture quotidienne, où le savoir, le travail, la fête, les rapports humains, les relations à l’animal ou à la nature s’entremêlent et composent, par-delà la dureté de la condition et les différences de classe, un monde commun, un socle culturel partagé. En cela, il s’oppose à la culture moderne puis postmoderne où, par-delà les moments d’effusion collective, dominent le culte rendu à l’individu, la consommation de la marchandise et de l’objet-lieu muséifié ou folklorique, la fragmentation des domaines de l’existence individuelle et des sphères de la vie sociale. Autrement dit, le monde du paysan doit être détruit pour que progressent la division, la séparation par lesquelles l’homme fait éclater son unité et s’éloigne de ses semblables.
6. L’homme de la valeur d’usage, de l’espace limité, de la lenteur du temps et de l’acceptation de la puissance de la nature et de la succession des saisons. Par là aussi, il apparaît étranger à quelques-unes des valeurs cardinales du déploiement capitaliste-productiviste et de l’ethos d’Homo consumeris et connecticus : la vitesse, l’instantanéité, l’éphémère, la contraction de l’espace et du temps par la circulation, l’obsolescence programmée, la prédation, l’illimitation, etc. Il est signe de permanence là où la modernité fonctionne à l’accélération, il est symbole de prudence là où domine l’hubris, il porte le lien là où s’organise la dé-liaison. Il est, en un mot, l’habitant, dont il faut se défaire pour que progresse la perte des habitudes.
7. L’homme de l’attachement à la terre et à la Terre. En cela, il est une nouvelle fois une figure antithétique de la modernité, et du capitalisme productiviste et prométhéen. Face au projet univoque de déracinement, de mobilité et de précarité généralisés, il a toujours symbolisé plus que tout autre l’homme aux attaches, inscrit dans le milieu, dépendant de la terre comme du ciel, et il réaffirme aujourd’hui le « vivre au pays », l’exigence de stabilité, le souci de la diversité, les mérites des racines, désormais ouvertes sur l’universel. Face au projet de mobilisation totale et à la transformation de toute « chose » (espèces végétales, animales ou humains, richesses du sol ou du sous-sol, créations des technosciences ou de la culture, etc.) en « ressources » d’un processus productif et marchand illimité, il incarne mieux que tout autre l’homme précapitaliste, l’homme à qui la nature est prêtée, l’homme du sol et non du « hors-sol », l’homme pour lequel la technique doit être subordonnée au besoin humain du monde et de la Terre. Face au projet de conquête, de colonisation de l’espace et d’un déménagement possible de l’espèce humaine sur une autre planète, il est enfin la figure la plus terrestre de la vie terrestre. Une nouvelle fois, l’habitant, qui doit disparaître afin que progresse le « décollage ».
À lire ces raisons du sacrifice de l’homme-paysan, on comprend beaucoup mieux en quoi il a été et reste encore un parfait bouc émissaire de la modernité. Aussi, malgré l’image et la place positives qu’il a conquises auprès d’une partie de l’opinion française, européenne ou mondiale, est-il hautement probable que le sacrifice, hélas, se poursuive, s’opérant soit de façon violente par sa liquidation directe lors de conflits armés et de catastrophes, soit « pacifique » par sa mutation vers d’autres milieux socioprofessionnels ou sa transformation en agriculteur productiviste. Pour qu’il en aille autrement, il faudrait que se produise un bouleversement complet de l’ordre politique et de la société capitaliste-productiviste dont on ne peut, au mieux et pour l’heure, que percevoir certains signes. D’une façon ou d’une autre, ils correspondent à cette montée d’une société prudente, solidaire et pluraliste, mâtinée de désobéissance civile, que nous évoquions dès l’introduction, dans le sillage de nos premières réflexions sur la Confédération paysanne. Ils se manifestent d’abord dans les combats contre la domination de l’hyperclasse et ses politiques néolibérales, la démesure des technosciences et leurs logiques d’artificialisation et d’appropriation du vivant, les mystifications électorales et technocratiques de la démocratie représentative et du « dialogue social », les grands projets inutiles et imposés (GPII), l’installation des fermes-usines ou les usines que l’on ferme ou délocalise, etc. Mais on les retrouve aussi, généralement logés dans les interstices de la société, dans ces nouvelles façons de vivre, c’est-à-dire de décider, de produire, d’échanger ou de se cultiver, qui se fondent sur l’idéal de l’auto-organisation, promeuvent la sobriété volontaire, le lien civil, le commun et réactualisent ainsi souvent des valeurs d’usage précapitalistes et paysannes. Tous ces mouvements témoignent, indiscutablement, de la profondeur et de la vitalité des aspirations à une société postcapitaliste et postproductiviste. Mais on ne saurait, en même temps, se leurrer ! Ils s’opposent fréquemment sur le degré de radicalité de la transformation, les formes institutionnelles que cette société pourrait revêtir, les stratégies à adopter vis-à-vis des pouvoirs existants, et ils ne représentent surtout, pour l’instant, qu’une fraction bien limitée de la population. La grande majorité, de bon gré ou malgré elle, accepte l’ordre – ou le chaos organisé – actuel. Et l’on ne saurait non plus, évidemment, oublier que du côté de l’oligarchie régnante, hubris, cynisme et force sont plus que jamais réunis et que, donc, on ne lâchera rien sans y être contraint, sinon quelques miettes mystificatrices destinées à durer. Aussi nous garderons-nous, pour conclure, de tout excès, d’optimisme ou de pessimisme. La graphie raisonnable est sans doute celle-ci…
Yves Dupont et Pierre Bitoun
-
https://comptoir.org/2017/01/18/pierre-bitoun-le-sacrifice-des-paysans-cest-celui-de-tous-les-autres/ ↑
-
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/suicide-des-agriculteurs-une-association-tente-d-enrayer-la-tendance-en-les-accompagnant-2865035.html ↑
-
https://terredeliens.org/national/actu/pour-ses-20-ans-terre-de-liens-lance-un-appel-%C3%A0-revenir-sur-terre-04-12-2023/ ↑
-
James C. Scott, Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, 2017 ; Zomia ou l’art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est, 2009. ↑
-
Voir l’excellente série documentaire Le temps des paysans encore diffusée actuellement : https://www.arte.tv/fr/videos/109393-001-A/le-temps-des-paysans-1-4/ ↑




