
Sentiment de supériorité et résistance au changement existent dans toutes les cultures
« Toute culture opère un partage de l’humanité entre d’une part elle-même, qui s’affirme comme représentation par excellence de l’humain, et les autres, qui ne participent qu’à un moindre titre à l’humanité[1]. »
– Pierre Clastres, anthropologue
« L’ethnocentrisme, c’est-à-dire la croyance en la supériorité de sa propre culture, est vital pour l’intégrité de toute société. Mais l’ethnocentrisme peut menacer le bien-être d’autres peuples lorsqu’il est instrumentalisé pour imposer des normes inadaptées. […] La stabilité et l’ethnocentrisme sont des caractéristiques fondamentales de toutes les cultures qui ont établi un système socioculturel durable. »
– John H. Bodley, anthropologue
J’ai traduit un extrait du livre Victims of Progress (1975) de l’anthropologue John H. Bodley où il explique pourquoi l’ethnocentrisme – la croyance en la supériorité de sa propre culture – est indispensable aux peuples tribaux pour préserver leurs sociétés des intrusions et perturbations externes. Ce texte est complété par un extrait de Race et histoire (1952) de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss qui insiste lui sur l’universalité de l’ethnocentrisme, aussi bien chez les groupes tribaux que dans les grandes civilisations.
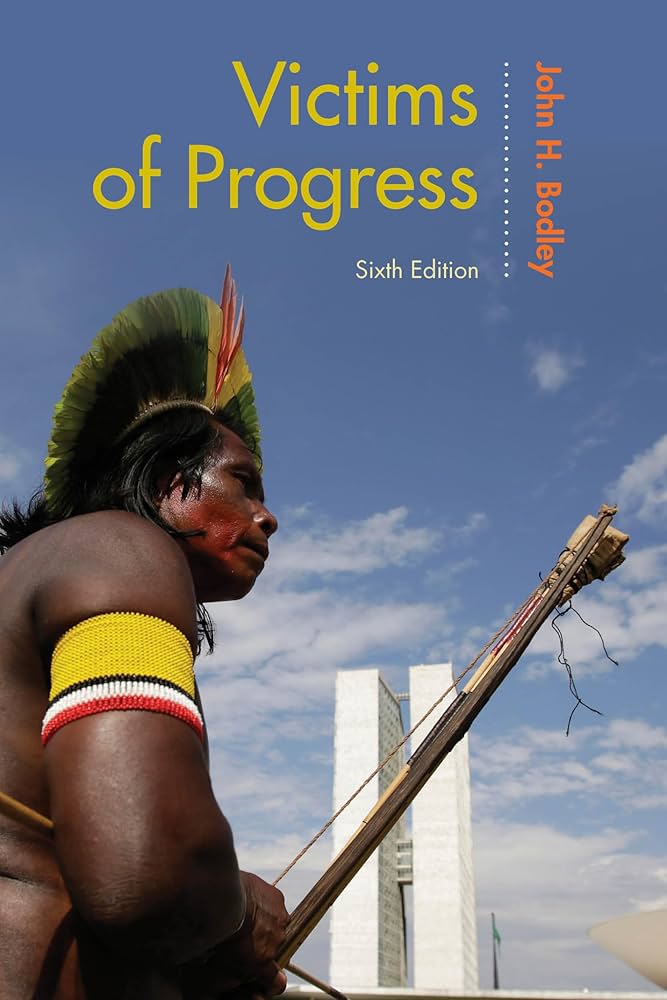

Le corollaire de l’ethnocentrisme, c’est la résistance au changement. La valorisation délirante de l’instabilité et des bouleversements n’existe que dans les sociétés industrielles et marchandes. Quand on regarde comment fonctionnent les autres groupes culturels ailleurs dans le monde, ils valorisent la stabilité, l’expérience, le savoir empirique des anciens, etc. Ériger l’innovation comme un idéal culturel apparaît comme une anomalie au sein de l’humanité. Il faut en effet être complètement cinglé pour valoriser l’insécurité et la précarité omniprésentes dans les sociétés industrialisées à cause des changements constants (technologiques, économiques, législatifs, sociaux, culturels, etc.).
FIERTÉ CULTURELLE CONTRE PROGRÈS
La fierté et la défiance de nombreux peuples tribaux face à un changement culturel forcé venu de l’extérieur sont indéniables, et ont souvent été commentées par des personnes étrangères à leur culture. La capacité des cultures tribales à résister aux intrusions extérieures est liée à leur degré d’ethnocentrisme, c’est-à-dire jusqu’à quel point les individus se sentent autonomes et convaincus que leur propre culture est ce qu’il y a de mieux pour eux. La caractéristique de cet ethnocentrisme est le refus catégorique du sentiment d’infériorité, même en présence d’une force étrangère accablante.
Un chef guerrier de la tribu invaincue des Xavante (Shavante) du centre du Brésil offre un exemple de cette forme d’assurance, sereine mais provocatrice. Ce chef avait personnellement participé en 1941 au massacre de sept hommes d’une mission « pacificatrice » envoyée par le gouvernement brésilien pour mettre fin à cinquante ans de résistance acharnée des Xavante à la civilisation. Comme preuve supplémentaire de leur dédain pour les intrus, les Xavante ont tiré des flèches sur un avion de l’armée de l’air et ont brûlé les cadeaux largués par l’appareil[2]. Après qu’une communauté Xavante ait finalement accepté les propositions de paix du gouvernement en 1953, l’armée de l’air a emmené le chef à Rio de Janeiro pour lui montrer la supériorité de l’État brésilien et la futilité d’entrer à nouveau en résistance. À la stupéfaction générale, il a observé Rio, même depuis les airs, dans un calme absolu. Il a ensuite été conduit au beau milieu d’un stade de football avec des milliers de supporters qui l’applaudissaient. On lui a fait remarquer à quel point l’État brésilien était puissant et qu’il était imprudent pour les Xavante de lui faire la guerre. Le chef n’a pas bronché et a répondu simplement : « C’est la terre de l’homme blanc, la mienne est la terre des Xavantes[3] ». Les Xavante ont milité pour la défense de leurs terres depuis la « pacification ». Ils ont expulsé par la force les colons et ont occupé les bureaux du gouvernement pour obliger les autorités à tenir leur promesse de protection juridique[4]. Le leader des Xavantes, Mario Juruna, a porté la lutte plus loin dans l’arène politique en se faisant élire à la Chambre des représentants du Brésil en 1982. Juruna a mené une campagne efficace en faveur des droits fonciers des Indiens du Brésil, tant au niveau national qu’international.
LE PRINCIPE DE STABILISATION
Selon les théories de l’évolution, de l’adaptation et de l’intégration culturelles, la résistance au changement s’entend comme un processus culturel dirigé par l’humain. Quand les gens ajustent progressivement les systèmes techniques, sociaux et idéologiques de leur culture pour s’adapter durablement à un environnement spécifique, d’autres arrangements culturels deviennent de plus en plus difficiles voire impossibles à accepter. Car ces derniers pourraient déclencher des changements à grande échelle, avec des conséquences imprévisibles. La résistance au changement – qu’il s’agisse d’échapper à de nouveaux modèles culturels, d’un ethnocentrisme exacerbé ou d’une hostilité ouverte à l’égard des étrangers – peut donc être considérée comme un moyen d’adaptation important. Elle fonctionne comme un « mécanisme d’isolement culturel » pour protéger les sociétés durables des effets perturbateurs d’éléments culturels étrangers[5]. La « stabilité » qui en résulte fait référence à une absence relative de changement dans les principaux modèles culturels. Cette stabilité n’implique pas une absence totale de changement dans toutes les nuances d’une culture, car les gens apportent constamment de petites modifications à leur culture tout en maintenant constants les modèles dominants. La stabilité globale est une caractéristique tellement fondamentale des cultures qu’elle a été formulée comme un principe général : « Une culture au repos tend à rester au repos[6] ». Un corollaire de ce principe dit de stabilisation est le suivant :
« Lorsqu’elle est soumise à des forces extérieures, une culture subira si nécessaire des changements spécifiques dans une certaine mesure seulement et avec le souci de préserver inchangés sa structure et ses valeurs fondamentales[7]. »
Comme les agents du changement le savent bien, la résistance au changement repose entre autres sur la résistance naturelle ou l’inertie des modèles culturels déjà établis. Mais la résistance au changement provient aussi de l’anticipation du risque lié à la nouveauté. Les groupes humains sont conscients que l’adoption de modèles culturels qui n’ont pas encore fait leurs preuves présente des risques. Soit les avantages liés à l’adoption de nouvelles méthodes semblent compenser les risques, soit une forme de coercition est nécessaire pour forcer le changement. Cependant, les agents du changement convaincus de leur propre supériorité culturelle ont tendance à oublier que les craintes des autochtones concernant les dangers d’innovations non validées par l’expérience peuvent être pleinement justifiées. Les peuples qui rejettent des modèles culturels non éprouvés tels que les céréales, les pesticides et les engrais chimiques prétendument miraculeux peuvent s’avérer à long terme plus sages et mieux adaptés à leur environnement naturel.
Pour les peuples qui vivent au sein de cultures relativement soutenables et autonomes, la résistance au changement est une valeur positive. Ce n’est que dans les sociétés marchandes que l’on met autant l’accent sur la poursuite du changement en tant qu’idéal culturel. Parmi ceux dont le métier est de promouvoir le changement, la stabilité culturelle se voit attribuer une connotation péjorative. Elle est identifiée à l’arriération et à la stagnation.
John H. Bodley
L’ETHNOCENTRISME
Il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu’elle est : un phénomène naturel, résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés ; ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité ou de scandale ; dans ces matières, le progrès de la connaissance n’a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d’une vue plus exacte qu’à l’accepter ou à trouver le moyen de s’y résigner.
L’attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides puisqu’elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. « Habitudes de sauvages », « cela n’est pas de chez nous », « on ne devrait pas permettre cela », etc., autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi l’Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque (puis gréco-romaine) sous le même nom de barbare ; la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or derrière ces épithètes se dissimule un même jugement : il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l’inarticulation du chant des oiseaux, opposées à la valeur signifiante du langage humain ; et sauvage, qui veut dire « de la forêt », évoque aussi un genre de vie animale, par opposition à la culture humaine. Dans les deux cas, on refuse d’admettre le fait même de la diversité culturelle ; on préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit.
Ce point de vue naïf, mais profondément ancré chez la plupart des hommes, n’a pas besoin d’être discuté puisque cette brochure en constitue précisément la réfutation. Il suffira de remarquer ici qu’il recèle un paradoxe assez significatif. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les « sauvages » (ou tous ceux qu’on choisit de considérer comme tels) hors de l’humanité, est justement l’attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. On sait, en effet, que la notion d’humanité, englobant, sans distinction de race ou de civilisation, toutes les formes de l’espèce humaine, est d’apparition fort tardive et d’expansion limitée. Là même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, il n’est nullement certain – l’histoire récente le prouve – qu’elle soit établie à l’abri des équivoques ou des régressions. Mais, pour de vastes fractions de l’espèce humaine et pendant des dizaines de millénaires, cette notion paraît être totalement absente. L’humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village ; à tel point qu’un grand nombre de populations dites primitives se désignent d’un nom qui signifie les « hommes » (ou parfois – dirons-nous avec plus de discrétion – les « bons », les « excellents », les « complets »), impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus – ou même de la nature – humaines, mais sont tout au plus composés de « mauvais », de « méchants », de « singes de terre » ou d’« œufs de pou ». On va souvent jusqu’à priver l’étranger de ce dernier degré de réalité en en faisant un « fantôme » ou une « apparition ». Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l’Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d’enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s’employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leur cadavre était, ou non, sujet à la putréfaction.
Cette anecdote à la fois baroque et tragique illustre bien le paradoxe du relativisme culturel (que nous retrouverons ailleurs sous d’autres formes) : c’est dans la mesure même où l’on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l’on s’identifie le plus complètement avec celles qu’on essaye de nier. En refusant l’humanité à ceux qui apparaissent comme les plus « sauvages » ou « barbares » de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la barbarie.
Sans doute les grands systèmes philosophiques et religieux de l’humanité – qu’il s’agisse du bouddhisme, du christianisme ou de l’islam, des doctrines stoïcienne, kantienne ou marxiste – se sont-ils constamment élevés contre cette aberration. Mais la simple proclamation de l’égalité naturelle entre tous les hommes et de la fraternité qui doit les unir, sans distinction de races ou de cultures, a quelque chose de décevant pour l’esprit, parce qu’elle néglige une diversité de fait, qui s’impose à l’observation et dont il ne suffit pas de dire qu’elle n’affecte pas le fond du problème pour que l’on soit théoriquement et pratiquement autorisé à faire comme si elle n’existait pas. Ainsi le préambule à la seconde déclaration de l’UNESCO sur le problème des races remarque judicieusement que ce qui convainc l’homme de la rue que les races existent, c’est l’« évidence immédiate de ses sens quand il aperçoit ensemble un Africain, un Européen, un Asiatique et un Indien américain ».
Les grandes déclarations des droits de l’homme ont, elles aussi, cette force et cette faiblesse d’énoncer un idéal trop souvent oublieux du fait que l’homme ne réalise pas sa nature dans une humanité abstraite, mais dans des cultures traditionnelles où les changements les plus révolutionnaires laissent subsister des pans entiers et s’expliquent eux-mêmes en fonction d’une situation strictement définie dans le temps et dans l’espace. Pris entre la double tentation de condamner des expériences qui le heurtent affectivement, et de nier des différences qu’il ne comprend pas intellectuellement, l’homme moderne s’est livré à cent spéculations philosophiques et sociologiques pour établir de vains compromis entre ces pôles contradictoires, et rendre compte de la diversité des cultures tout en cherchant à supprimer ce qu’elle conserve pour lui de scandaleux et de choquant.
Claude Lévi-Strauss
Pierre Clastres, « De l’ethnocide », in L’Homme, 1974. ↑
Anonymous, 1945, “Indians shoot at plane,” Life 18 (March 19): 70–72. ↑
52. D. G. Fabre, 1963, Más Allá del Rio das Mortes, Buenos Aires: Ediciones Selectas, 34–45 ↑
53. David Maybury-Lewis, 1983, “The Shavante struggle for their lands,” Cultural Survival Quarterly 7(1): 54–55. ↑
Betty J. Meggers, 1971, Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise, Chicago: Aldine, 166 ↑
Thomas G. Harding, 1960, “Adaptation and stability,” in Evolution and Culture, ed. Marshall Sahlins and Elman Service, Ann Arbor: University of Michigan Press, 54. ↑
Ibid. ↑




